
- Recherche par auteur ou oeuvre
- Recherche par idée ou thème
- Recherche par mot clé
- Détecteur de plagiat
- Commande & correction de doc
- Publier mes documents
- Nos astuces
- Vie étudiante
- Témoignages
Consultez tous nos documents en ligne !
à partir de 9.95 € sans engagement de durée

Exemples de sujets de dissertation en Philosophie sur la morale
La morale est-elle une condition de la vie en société ? L'amoralité est-elle un péché ? La morale est l'une des notions de Philosophie à étudier pour le Bac. Voici une liste de sujets que vous pouvez rencontrer lors d'une dissertation.

Credit Photo : Freepik wayhomestudio

Sujet 1 - La morale est-elle une condition de la vie en société ?
La morale, est-ce une condition à la vie en société ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure. I. Oui A. L'homme est un animal social donc il se doit de vivre selon ce que le groupe nécessite, donc de manière altruiste (Aristote) B. Et même politique : il n'est pas seulement voué à vivre avec ses pairs, mais aussi à bâtir une civilisation et à vivre selon les règles de celle-ci, c'est-à-dire les valeurs
II. Cependant A. Schopenhauer estime que la morale n'est pas un devoir, mais ce à quoi on consent B. Auquel cas, la morale ne peut être une condition
III. Conclusion : Cependant, la morale est quasiment intuitive chez l'Homme civilisé, si bien qu'elle est omniprésente en lui, car consentie et intégrée
Sujet 2 - La morale doit-elle se soucier des conséquences ? (Anscombe, Aristote, Kant, Berkeley)
De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale. Doit-elle se soucier de ses conséquences ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.
I. L'éthique de la vertu, la morale déontologique, et le conséquentialisme. Doit-on nécessairement adopter le conséquentialisme ? (Elizabeth Anscombe, Aristote, Kant, Berkeley) A. La morale déontologique, du phronesis d'Aristote à la conscience morale moderne (Aristote et sa morale centrée sur les vertus, « Éthique à Nicomaque », puis Berkeley avec l'idéalisme absolu. Critique de l'éthique déontologique et de l'éthique de la vertu, différence entre un déontologiste et un utilitariste) B. Du conséquentialisme et de ses préceptes, opposition entre Anscombe et Kant, (Doctrine de la vertu ébauchée par Kant dans « La métaphysique des moeurs » en 1795, approche de la vertu universelle, puis critique d'Anscombe, G.E.M : La philosophie morale moderne, 1958) C. L'éthique de la vertu, éthique téléologique entre le plus grand « bien » et le moins « mauvais ». Refus de toutes les doctrines selon Anscombe, critique du conséquentialisme comme de l'utilitarisme, en revenir aux préceptes d'Aristote ?
II. L'utilité de la morale selon Kant ; de la bonne volonté de tout acte moral, le conséquentialisme n'est pas nécessaire A. Entre la légalité et la moralité, agir conformément au devoir et agir par devoir (« La Critique de la raison pratique », Kant, 1788) B. Les impératifs catégoriques ; Que dois-je faire ? Entre liberté et volonté. (Métaphysique des Moeurs, Kant, 1795, impératifs hypothétiques, impératifs catégoriques) C. Les conséquences d'agir selon la bonne morale, agir selon le « Summum bonum » (Le souverain bien chez Kant, dichotomie entre morale religieuse et morale philosophique)
III. L'utilitarisme comme réponse au conséquentialisme (Bentham, Aristote, John Stuart Mill) A. « Le plus grand bonheur du plus grand nombre », Bentham , principe d'utilité sociale (« An Introduction to the Principles of Morals and Legislation », 1780) B. Utilitarisme indirect et négatif de John Sutart Mill , le plaisir n'est plus la fin de la moralité, maximisation du bien-être et minimisation de la souffrance C. Aristote et son idée de « juste milieu » comme opposition à l'utilitarisme
Sujet 3 - L'amoralité est-elle un péché ?
I. Oui A. Quand elle est motivée par le simple désir de survie (évolutionnisme, théorie du gène égoïste) B. C'est un vice au vu de ce qu'estime la religion (paresse religieuse)
II. Cependant A. L'amoralisme peut créer selon Nietzsche des génies, qui pourront changer les moeurs B. Et aussi amener de nouvelles avancées technologiques, artistiques, etc.
III. Conclusion : L'amoralité est un vice théoriquement, mais peut provoquer des avancées non négligeables, ce qui signifie qu'elle est morale uniquement par ses conséquences
Sujet 4 - Le Souverain Bien est-il accessible seulement aux hommes bons ?
La morale est à l'origine du concept de Souverain Bien , soit le plus haut bien possible, chez Kant. Cependant, le Souverain bien n'est-il accessible qu'aux hommes bons ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.
I. Non, principe de la grâce efficace et du Jansénisme (Augustinus, Jansen, 1640) A. Le jansénisme et sa conception de l'homme bon par déterminisme en opposition aux Jésuites B. Il est uniquement possible de faire le bien, car nous sommes destinés à faire le bien par choix de Dieu (la Grâce. Pascal, « Pensées » , 1670)
II. Oui, dans l'hypothèse d'un monde suprasensible, auprès de Dieu (Kant) III. Conclusion
Sujet 5 - La morale apporte-t-elle le bonheur ?
I . Oui A. D'après Kant, la vraie morale est un devoir et va donc contre nos intérêts personnels, elle peut être pénible B. C'est d'ailleurs à travers sa pénibilité qu'on reconnaît sa nature et sa valeur II. Cependant A. Kant estime que respecter les lois morales, c'est à la fois pour le bien commun B. Mais aussi pour espérer atteindre le bonheur III. La morale offre cependant un bonheur commun, beaucoup moins personnel que la satisfaction de ses propres désirs
Sujet 6 - La morale est-elle politique ?
La morale est certes un gage de vertu, mais est-elle également politique ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.
I. Oui A. La morale est un devoir citoyen, elle se doit d'être définissable par des règles strictes pour être observée et respectée B. Elle est d'ailleurs retravaillée à travers l'éthique pour convenir aux besoins d'une population donnée
II. Cependant A. La morale est finalement égoïste parce que par le sacrifice que l'on fait en la suivant, on espère secrètement atteindre le bonheur B. L'immoralité ou l'amoralité ne sont pas forcément punies par la loi, même si elles le sont par Dieu (voir le péché de la paresse dans les 7 péchés capitaux)
III. Conclusion : Dans une société capitalisme, on peut cependant se demander s'il n'existe pas encore des reliquats de la loi du plus fort, en dépit des lois morales du citoyen
Sujet 7 - La morale est-elle une obligation ou une liberté ?
La morale est-elle une obligation ou une liberté ? Nous justifierons ce premier point, puis nous le contrebalancerons avec le second avant de conclure.
I. Obligation A. La morale est une obligation si l'on veut être un citoyen, donc appartenir à un groupe humain civilisé B. C'est aussi une obligation envers soi puisque c'est la condition du bonheur le plus haut
II. Liberté A. La morale est le sentiment dont le contrat social est le substitut artificiel. Celui-ci est une liberté, puisqu'il permet de s'émanciper des injustices nées de la vie en groupe B. La morale, créée par la conscience, est une illusion qui permet de responsabiliser autrui par rapport à ses actes. Paradoxalement, c'est en ce qu'on choisit de vivre selon cette illusion qu'on est le plus moral
III. Conclusion : La morale est à la fois une obligation et une liberté, dans le cadre d'une vie civilisée. Mais quelle est la valeur de l'amoralité dans ce contexte ?
Sujet 8 - Un être sans morale est-il humain ?
La morale est apparemment propre à l'humain, mais un être dénué de morale peut-il être humain lui aussi ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.
I. Oui A. Un être humain naît amoral, c'est la condition première de l'humain B. Ce qui caractérise en premier l'humain pour Freud, ce sont ses pulsions et donc sa propension au vice
II. Cependant A. Par exemple, une personne ne doit pas garder les mêmes droits que les autres s'il commet un crime en regard de la loi de l'État ou des lois morales, il est donc traité comme moins humain que les autres B. C'est un humain inférieur, puisqu'il choisit ainsi de céder à ses penchants égoïstes en dépit du groupe
III. Conclusion : Un humain dénué de morale pourrait-il être un humain supérieur ?
Sujet 9 - La morale est-elle utile ?
De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale. Mais était-ce bien utile ? La morale est-elle utile ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure. I. Non A. C'est une divagation philosophique comme toutes les autres, la majorité de ses théorisations ne sont pas infaillibles ou applicables (voir la morale de Kant) B. Elle n'est pas fondamentalement utile à la survie ou à la réflexion, ni même à la vie en communauté puisqu'il suffit d'agir selon le devoir moral (donc hypocritement) pour ne pas être puni
II. Cependant A. Elle permet de lier un peuple, diriger un pays, etc. B. Elle permet de devenir pleinement humain, c'est le témoignage de la conscience, on peut agir autrement que par la loi du plus fort
III. Conclusion : La morale est effectivement utile pour affirmer notre humanité. Est-ce la seule façon pour nous de nous différencier des animaux ?
Sujet 10 - Qu'est-ce qu'être moral ?
De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale, sûrement pour pouvoir l'appréhender comme mode de vie. Mais qu'est-ce qu'être moral ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.
I. Ce que ce n'est pas A. Ne pas être immoral B. Ne pas être amoral II. Ce que c'est A. Agir par devoir moral et pas selon le devoir moral B. Considérer également les conséquences morales de ses actes
III. Conclusion : Être moral, c'est une façon de vivre. Mais un être humain peut-il être moral ?
Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !
Articles liés.

Exemples de sujets de dissertation sur Les Fleurs du Mal...

Sujets de dissertation sur Olympe de Gouges et ses oeuvres

Guide et conseils pour réussir ses révisions et ses examens
Articles récents

Corrigé bac français : Ponge, La rage de l'expression

Corrigé bac français : Hélène Dorion, Mes forêts

Corrigé bac français : Commentaire de texte de Claire de...

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans
La morale > plans rédigés disponibles
Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

La liberté
Liste des sujets traités, commentaires disponibles.

Apprendre la philosophie
Découvrir la philosophie pas à pas
Exemples d’introduction de dissertation en philosophie
Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂
Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Comme ça n'est pas la première fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂
Afin que vous compreniez mieux comment réaliser une bonne introduction de dissertation, je vous montre ici plusieurs exemples d’introduction de dissertation en philosophie sur des sujets différents, vous pouvez voir la méthode en VIDEO ici . Pour davantage d’information sur la méthode à suivre vous pouvez regarder cet article sur la manière de réussir son accroche , et ces deux autres articles sur la problématique et la méthode de l’introduction de manière plus générale.
Je vous rappelle que votre introduction de dissertation en philosophie doit comporter une accroche , un rappel du sujet, une problématique comprenant une définition des termes du sujet et une annonce de plan.
Pour plus de clarté, je précise à chaque fois entre parenthèses à quel élément de la méthode les différents passages de l’introduction correspondent. Par ailleurs, vous trouverez dans le sujet 1, un exemple d’accroche utilisant un exemple, et dans les sujets 2 et 3, des exemples d’accroches utilisant plutôt des citations.
Sujet 1 : Introduction philosophique : Avons-nous le devoir de faire le bonheur des autres ?
Dans le film « Into the Wild », le héro Christopher, s’enfuit pour partir vivre seule dans la nature. Il essaie, ainsi, d’échapper à l’influence de ses parents qui veulent pourtant son bonheur. Christopher rejette le mode de vie de ses parents, et pense, au contraire, être heureux en se détachant des choses matériels et en s’éloignant de la société. Ce faisant, on peut en déduire qu’il est souvent difficile de savoir ce qui rendra heureux un individu. Or, si nous ne savons pas réellement ce qui les rendra heureux, comment pourrait-on avoir le devoir de faire le bonheur des autres ? Et pourtant n’avons nous pas l’obligation, de leur donner au moins le minimum pour être heureux ? (Accroche qui montre le problème c’est-à-dire que la réponse au sujet n’est pas évidente) . Avons-nous alors le devoir de faire le bonheur des autres ? ( Rappel du sujet). A première vue , nous pourrions penser que nous avons effectivement le devoir de faire le bonheur des autres, car ce serait une obligation morale d’agir de manière à aider les autres à atteindre un état de satisfaction durable et global. En effet, rendre les autres heureux semble être une bonne chose et quelque chose que l’on peut rationnellement souhaiter. ( Première réponse au sujet ) Mais , n’est-ce alors pas vouloir imposer aux autres une certaine manière d’être heureux ? En prétendant faire le bonheur des autres, ne risque-t-on pas, au contraire, de faire son malheur ? Dans ce sens, dire que nous avons l’obligation de rendre les autres heureux pourrait être difficile à défendre car comment avoir le devoir de rendre les autres heureux si nous ne pouvons savoir ce qui les rendra effectivement tel ? (Deuxième réponse qui montre que la réponse au sujet n’est pas évidente) . Dans un premier temps, nous verrons
🚀🚀🚀 Pour plus de conseils de méthode et des fiches sur les grandes notions suivez-moi sur Instagram ici.
Sujet 2 : Prendre son temps, est-ce le perdre ?
« Nous n’avons pas reçu une vie brève, nous l’avons faite telle ». Sénèque dans De la Brièveté de la vie , remarque ainsi que les hommes qui se plaignent d’avoir une vie courte sont, en réalité, responsables de cela, car ce sont eux qui en perdant leur temps la rendent courte. Pourtant, si les hommes perdent leur temps selon lui, ça n’est pas parce qu’ils prendraient trop leur temps, mais parce qu’ils ne réfléchissent pas à la meilleur manière d’user de ce temps. Ils peuvent très bien s’agiter sans cesse et être fort occupés tout en perdant leur temps car ils ne l’utilisent à rien de significatif. ( Accroche ) Alors, prendre son temps, est-ce le perdre ? ( Rappel du sujet ) A première vue, si par prendre son temps, on entend faire les choses avec lenteur, alors prendre son temps, cela pourrait signifier le perdre car c’est oublier alors que nous sommes des êtres mortels et que notre temps est limité. Le temps est une chose trop précieuse pour que l’on n’y fasse pas attention. Celui qui est lent perd alors son temps. ( Première réponse un peu naïve qui repose sur une première définition de prendre son temps – première partie de la problématique) Mais , ne pourrait-on, au contraire, défendre l’idée que prendre son temps c’est au contraire bien en user ? Est-ce nécessairement parce que l’on agit vite et que l’on fait beaucoup de choses dans sa journée que l’on utilise bien son temps ? Nous pourrions, au contraire, remarquer que si nous occupons nos journées à des actions sans réel but alors nous perdons tout autant notre temps. Prendre son temps cela pourrait donc être, prendre possession de son temps en sachant précisément à quoi on l’utilise et pourquoi. ( Deuxième réponse qui repose sur une deuxième signification possible de « prendre son temps » et montre que la réponse au sujet n’est pas évidente – deuxième partie de la problématique ). Dans un premier temps, nous verrons que prendre son temps cela peut signifier le perdre, si nous sommes inconscients du caractère précieux du temps. Puis nous nous demanderons dans quelle mesure néanmoins prendre son temps et l’utiliser de manière réfléchie, ça n’est pas, au contraire, bien user de son temps. Enfin, nous envisagerons que quelque soit notre façon de vivre, il est inéluctable de perdre son temps dans la mesure où le temps est quelque chose qui nous échappe fondamentalement. (Annonce du plan)
Sujet 3 : Faut-il craindre la mort ?
« Il faut donc être sot pour dire avoir peur de la mort, non pas parce qu’elle serait un événement pénible, mais parce qu’on tremble en l’attendant. » Selon Epicure dans la Lettre à Ménécée , il n’est pas raisonnable de craindre la mort, car il définit la mort comme « absence de sensation ». De ce fait, la mort ne nous fait pas souffrir puisqu’elle est absence de sensation, en revanche si nous craignons la mort de notre vivant, alors nous souffrons par avance inutilement. Nous pourrions pourtant remarquer que si la mort ne fait pas souffrir, le fait de mourir peut être douloureux. (Accroche qui montre que le sujet pose un problème) Faut-il alors craindre la mort ? (Rappel du sujet) A première vue , craindre la mort pourrait être utile pour nous car la crainte de la mort peut nous pousser à être plus prudent. Il faudrait alors craindre un minimum la mort pour espérer rester en vie. ( Première réponse un peu naïve au sujet ). Mais , ne pourrait-on dire, au contraire, qu’il ne faut pas craindre la mort ? En effet, il semble que cela n’a pas réellement de sens et d’utilité de craindre quelque chose qui arrivera de toute façon et de se gâcher la vie à l’anticiper. (Deuxième réponse qui montre que la réponse n’est pas évidente et pose donc un problème) Nous allons donc nous demander s’il faut craindre la mort. Dans un premier temps nous verrons qu’il ne faut pas craindre la mort car elle n’est pas un malheur. Puis, nous verrons qu’il y a néanmoins des avantages à craindre la mort. Enfin, nous nous demanderons si craindre la mort n’est pas un non sens car cela nous empêche de bien vivre. (Annonce du plan)
J’espère que ces différents exemples d’introduction de dissertation en philosophie, vous auront aidé à comprendre ce que doit être une introduction de dissertation en philosophie.
▶️ Si vous voulez aller plus loin vous pouvez également regarder cet exemple d’introduction de dissertation en vidéo :
Articles similaires
Laissez un commentaire annuler la réponse..
- Terminale S
- Philosophie
- Cours : La morale : introduction
La morale : introduction Cours
La conscience morale de l'homme, la conscience morale pour définir le bien et le mal.
Étant privé de conscience ou du moins de conscience de soi, l'animal n'est pas le "sujet" de son comportement. L'animal ne prévoit pas son action .
L'homme est l'animal estimateur par excellence.
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale. Un écrit polémique , ( Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift ), trad. Patrick Wotling, Paris, éd. Le Livre de Poche, coll. "Classiques de la philosophie" (2000)
L'homme, au contraire, est conscient de lui-même . Il est capable de choix réfléchi. C'est cette aptitude au choix, cette conscience, qui lui permet de porter un jugement sur ses propres actions. Ainsi, il peut distinguer le bien et le mal.
L'association entre bien et plaisir : un premier frein à la conscience morale
Lorsque l'on part de cette définition de la morale comme capacité à différencier le bien et le mal, un premier frein à la morale se dessine.
Comme le fait observer Jean-Paul Sartre, ce que l'homme juge bien est trop souvent ce qui est bon pour lui. Il finit alors par suivre son intérêt personnel ou son bonheur personnel. La morale, qui doit définir le bien et le mal, devient alors une division du monde pour l'homme entre ce qui lui fait plaisir et ce qui ne lui fait pas plaisir.
Dès l'Antiquité, on trouve chez les philosophes cette association entre bien et plaisir :
- Par exemple, l'eudémonisme d'Épicure identifie le bien au bonheur.
- On peut également citer l'hédonisme, une philosophie antique qui identifie le bien au plaisir et le mal à la douleur.
Un eudémoniste (ou épicurien) se satisfait d'une vie où il a tout ce qui est nécessaire pour vivre : un logement, de la nourriture et un revenu. Un hédoniste veut toujours plus car rien n'est suffisant, il souhaite une plus grande maison, une nourriture abondante et un revenu de plus en plus élevé.
Dans la lignée de l'association entre bien et plaisir, Sigmund Freud évoque la position de l'enfant, qui juge juste ou injuste ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas. Il appelle cela le principe de plaisir et parle de "Moi-plaisir" . Lors de la construction de sa personnalité, le Moi de l'individu se constitue à partir du plaisir parce qu'il le trouve bon. Les enfants parlent très tôt de "morale". Pour eux, c'est la différence entre les "méchants" qui ne suivent pas la morale et les "gentils" qui suivent la morale. Ils appellent "méchants" ceux qui les contrarient et "gentils" ceux qui leur font plaisir. Même un objet peut être perçu comme "méchant" par un enfant s'il s'est cogné dessus. Ici, la morale ne sépare pas le bien et le mal, mais le juste de l'injuste, ou du moins ce qui paraît tel à l'enfant, puisque pour lui le « méchant », le déplaisir ou la douleur ne font qu'un avec ce qui est « injuste » à ses yeux, y compris par exemple la punition
Cette position infantile existe toujours dans l'inconscient de l'adulte. Lorsque quelque chose résiste à l'individu et qu'il la juge avec son âme d'enfant, il cherche "tout naturellement" un coupable , même un objet. Tout ce qui correspond à son désir ou plaisir est "bien" et tout ce qui lui fait obstacle est "mal".
Le glissement vers l'immoralité
L'association du bien au plaisir personnel conduit alors à l'immoralité, car l'homme sert avant tout son intérêt personnel.
En effet, l'homme est tenté de tout faire pour parvenir à satisfaire son propre plaisir, son propre bonheur. L'homme peut alors se détourner du bien collectif et agir de façon immorale.
Or ce type de comportement est paradoxal car l'être humain tire bien plus de bénéfices personnels du bon déroulement des affaires sociales en vue du bien collectif. C'est en partie ce qui est démontré par Kant avec l'insociable-sociabilité, c'est-à-dire la tendance de l'homme à entrer en concurrence pour s'affirmer, travaillant ainsi sans s'en rendre compte à une dynamique collective, ou par Rawls avec sa "Théorie de la Justice".
En cherchant par contre son propre bien seulement en dehors de la société, l'homme peut se perdre jusqu'à être malheureux, car sa satisfaction égoïste compromet l'équilibre social et celui des autres qu'il ignore ou méprise
Dans La République , Platon montre comment, en démocratie, une liberté excessive livrant le citoyen à lui-même, dans l'apparence d'une satisfaction de tous ses désirs, conduit peu à peu à la tyrannie. La société devenant anarchique, une autorité s'impose qui trace à nouveau des limites au désir individuel et rétablit "dictatorialement" le souci du bien commun.
Éduquer la conscience morale
L'éducation pour apprendre la morale.
La morale s'apprend, c'est une question d'éducation.
Pour Platon, "faire le mal" signifie ignorer le bien. Il affirme que le méchant est en réalité un ignorant. Platon en conclut que la conscience morale doit être éduquée. Ainsi, la morale n'est pas innée, et elle ne correspond pas à ce qui fait plaisir à l'individu ou à ce qui ne lui fait pas plaisir. Elle correspond à des règles qu'il faut apprendre.
Ceux qui identifient le bien au plaisir ne réfléchissent pas au fait que le plaisir aussi doit être éduqué. Le plaisir de l'enfant, déterminé par la nature, n'est pas celui de l'adolescent, ni de l'adulte. Ainsi, l'enfant n'a pas un goût culinaire inné : il préfère des aliments simples et peu variés à des préparations gastronomiques plus élaborées. Par conséquent, le plaisir n'est même pas le bien individuel puisque le plaisir évolue et doit lui aussi être éduqué. C'est l'éducation qui apprend à l'individu non seulement à séparer le bien du plaisir, mais encore à déterminer quels sont les "bons" plaisirs, c'est-à-dire ceux qui lui conviennent individuellement aux différentes étapes de sa vie.
Puisque l'homme est un "animal social", le bien individuel est une partie du bien commun et l'éducation morale est aussi une éducation civique. C'est pourquoi Platon consacre La République à la formation du citoyen. Si l'équilibre règne entre les différentes parties de l'âme (parties intellectuelle, volontaire et sensible) il régnera aussi entre les classes qui composent la cité (classes gouvernante, guerrière et artisanale). La conscience morale détermine également les notions de responsabilité individuelle et de conscience citoyenne.
Les théories de Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau a écrit à la fois sur l'éducation dans son « Émile ou de l'éducation » et sur la politique dans Du Contrat social . Dans chacune de ces œuvres, il cherche à résoudre le problème du passage de la nature où règne l'égoïsme, à la culture qui est de nature sociale. C'est l' éducation qui fait le lien, elle est à la fois morale puisqu'elle dote l'enfant d'autonomie, et politique puisqu'elle développe la responsabilité et permet ainsi aux hommes de décider et d'agir collectivement.
Ainsi, la responsabilité, acquise par l'éducation, est à la fois morale et politique. Ici, enseigner, c'est éduquer.
La morale pragmatique
Certains philosophes proposent d'enseigner une morale étrangère à tout pragmatisme (souci de l'efficacité, de la réussite) c'est-à-dire une "morale pure" qui ne s'attache qu'aux intentions.
Ce sont dans ces intentions que peuvent résider les principes de bien ou de mal du sujet de l'action.
Il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté.
Emmanuel Kant
Fondements de la métaphysique des mœurs , ( Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ), trad. Victor Delbos, Paris, éd. Le Livre de Poche (1993)
Kant entend par "bonne volonté" non seulement volonté intentionnelle (libre arbitre) et éclairée par la connaissance (raison pratique) mais également l'intention avec tous les moyens d'agir dont l'individu peut disposer. La bonne volonté s'apprend donc, il faut éduquer l'homme à faire bon usage de son libre arbitre, à raisonner et à définir les moyens qu'il a à sa disposition pour agir.
L e pragmatisme va plus loin. Selon William James, est moral ce qui permet de réussir à faire le bien. C'est l'efficacité qui prime : il ne s'agit plus simplement de définir le bien et le mal, il s'agit de savoir comment parvenir à faire le bien. Les moyens importent autant que la fin dans la mesure où ils la servent. Cela ne signifie pas que la fin doive être immorale, ou que le mal l'emporte sur le bien. Le pragmatisme n'est pas un immoralisme, mais il met l'accent sur la réussite. Ainsi, il convient ici d'éduquer l'homme à réfléchir aux conséquences de son action et à valoriser une morale qui repose sur la réussite de l'action par rapport à un but précis. Il n'y a plus rien de spontané dans cette morale, contrairement à l'intention kantienne, qui doit seulement être éduquée.
Dans le Gorgias , Platon compare le peuple à un enfant, les orateurs à un cuisinier, et le philosophe à un médecin. Selon lui, l'enfant sera toujours plus attiré par les plats du cuisinier qu'il ne le sera par les médicaments du médecin indépendamment du bien qu'ils lui apportent. Par ailleurs, le peuple sera toujours plus attiré par les paroles de l'orateur et les conseils du philosophe que par un bon dirigeant. Un pragmatique conseillerait probablement au médecin de cacher ses médicaments dans de doux plats pour que l'enfant les ingère.
Les possibles dérives de la morale utilitariste
Toutefois, l'éducation de la conscience morale connaît des limites.
En effet, enseigner une certaine vision de la morale peut conduire à des résultats négatifs. C'est le cas de la morale utilitariste qui réduit le bien et le mal à l'utilité collective ou non d'un acte.
Nous n'appelons bien ou mal que ce qui sert ou nuit à la conservation de notre être.
Baruch Spinoza
Éthique , ( Ethica ), trad. Bernard Pautrat, Paris, éd. Seuil, coll. "Points" (2010)
Cette morale est un compromis entre la "morale pure" et le pragmatisme qui insiste sur les moyens de la réussite. Le risque de l'utilitarisme réside dans sa mauvaise interprétation qui peut conduire à réduire le bien et le mal à l'utilité personnelle que l'on peut retirer de telle ou telle chose. Par ailleurs il y a un danger dans la mesure où il faut savoir qui a le pouvoir d'interpréter ce qui est utile ou non à la communauté.
Il semble après tout qu'éduquer la conscience morale ne peut suffire en raison du grand nombre de doctrines morales diverses.
De la morale à l'éthique
Une définition de l'éthique.
En philosophie, l'éthique est une discipline à part entière qui vise à mener des réflexions sur des cas où il peut exister un dilemme moral.
Le fondement de la réflexion éthique réside dans la notion d'altérité : on est tous l'autre d'un autre être humain, un sujet authentique et unique vivant aux côtés d'autres personnes. Cette dynamique a été notamment permise par Kant. Avec l'impératif catégorique, il souligne la nécessité de reconnaître en l'autre cette humanité qui fait de lui une finalité en lui-même. Cet autre est capable de choisir ce vers quoi il veut tendre, ce pour quoi il veut vivre.
Agis de manière à traiter la personne humaine, aussi bien en toi-même qu'en autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen.
L'esclavagisme représente la négation parfaite de la phrase de Kant. En réduisant à l'esclavage une personne, on la traite simplement comme un moyen.
L'éthique comme "philosophie première"
Emmanuel Lévinas considère l'éthique non pas comme une partie de la philosophie mais comme la philosophie première, c'est-à-dire fondamentale.
Le terme de philosophie première était autrefois celui de la métaphysique, donc de la connaissance. En le réservant à l'éthique, Lévinas fait passer la personne humaine en première position. Dépassant Kant qui valorisait la personne d'autrui à l'égal de la nôtre, Lévinas préconise un "humanisme de l'autre homme" . Cela signifie qu'il est moral d'aller jusqu'au sacrifice de soi pour autrui.
Mais la relation au visage est d'emblée éthique. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins dont le sens consiste à dire : "tu ne tueras point".
Emmanuel Lévinas
Éthique et Infini, Paris, éd. Fayard, coll. "Espace intérieur"
Pour Lévinas, le visage n'est pas la tête d'un autre homme. Décrire simplement le visage de l'Autre, c'est le chosifier (on dit aussi "le réifier"). Pour le philosophe, le visage de l'Autre c'est sa singularité, sa spécificité. Rencontrer l'Autre, le regarder, c'est reconnaître son humanité et c'est refuser d'attenter à sa vie.
Les champs d'application de l'éthique
L'éthique passe par la reconnaissance de tout un chacun comme un sujet conscient digne d'être considéré comme une finalité en soi.
Pour autant, l'éthique n'est pas une "nouvelle morale" mais bien une discipline à part entière. Ainsi l'éthique ne se contente pas de dénoncer mais d'interroger de véritables problèmes de manière éclairée.
Les questions que l'on retrouve dans l'éthique sont :
- Peut-on admettre la gestation pour autrui ?
- A-t-on le droit ou le devoir de maintenir artificiellement en vie une personne qui souffre et qui préférerait mourir ?
- Un État devrait-il ou non tenter d'uniformiser les cultures sur son territoire ?
Toutefois l'éthique est en réalité une discipline bien plus large, qui ne se limite pas au respect de l'être humain et qui s'attache à dénouer tous les dilemmes moraux qui peuvent se jouer au quotidien. Ainsi, avec la thématique du réchauffement climatique, est née la bio-éthique qui vise à s'interroger sur les mesures à prendre face aux dangers que l'homme fait courir à la nature. De même, avec la naissance de la notion de transhumanisme (l'"augmentation" de l'homme par la technologie) et d'intelligence artificielle apparaissent des questionnements infinis dans le champ de ce que certains appellent la techno-éthique. Dans cette mesure, l'éthique est aujourd'hui une des branches les plus actives de la philosophie.
Consulter le journal
Bac philo 2019, ES : le corrigé du 1er sujet « La morale est-elle la meilleure des politiques ? »
Nous publions ici le corrigé type du 1er sujet de l’épreuve de philosophie du bac réservé aux élèves de la série ES lundi 17 juin.
Temps de Lecture 5 min.
- Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections
- Partager sur Twitter
- Partager sur Messenger
- Partager sur Facebook
- Envoyer par e-mail
- Partager sur Linkedin
- Copier le lien
Voici un corrigé du premier sujet de l’épreuve de philosophie du bac 2019, série ES, que « Le Monde » vous propose en exclusivité, en partenariat avec Annabac, par Fabien Lamouche, professeur agrégé de philosophie.

Suivez notre direct « spécial philo » ce lundi : questions-réponses avec un professeur de philosophie, et corrigés de tous les sujets dès midi
Le sujet : « La morale est-elle la meilleure des politiques ? »
La problématique du sujet
• La « morale » est l’ensemble des règles relatives à la vie bonne, notamment à la distinction du bien et du mal. La politique désigne ici une pratique, voire un métier : la quête du pouvoir la manière de l’exercer.
• « Meilleur » est un terme ambigu : on peut entendre par là soit ce qui est plus efficace, soit ce qui est plus juste.
• Il faut donc s’interroger sur les limites que la morale peut éventuellement assigner à l’action politique. Le respect des règles morales doit-il primer sur l’efficacité ? Ne peut-on pas concilier les deux ?
Plan détaillé
1. La politique est soumise à une exigence d’efficacité
A. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DOIT PRÉVALOIR
• La politique est l’activité dont sont chargés un certain nombre d’hommes et de femmes lorsqu’ils sont à la tête d’une collectivité plus ou moins large, locale ou nationale. Est politique tout ce qui concerne les institutions et la vie en société : le principe qui doit prévaloir est celui de l’intérêt général.
• L’exercice du pouvoir est une grande responsabilité : celui qui en a la charge n’a pas le droit à l’erreur car ses décisions impliquent la tranquillité, la sécurité, bref la vie de tous ses concitoyens. Dans une démocratie, le politique doit répondre de ses décisions devant le peuple : ses décisions ont-elles été profitables à la collectivité ? S’est-il montré efficace ? C’est sur ce point qu’on le jugera.
B. LA MEILLEURE POLITIQUE EST LA PLUS EFFICACE
• Dans le Prince, Machiavel a théorisé une pratique du pouvoir centrée sur l’efficacité : selon lui, le gouvernant n’est pas soumis aux mêmes exigences que le particulier. S’il devait toujours respecter les règles morales, par exemple en disant toujours la vérité, il serait vite perdu et son État avec lui : ce serait se conduire comme un agneau parmi les loups. C’est le réalisme politique.
• C’est pourquoi le seul souci qu’il doit avoir est d’être efficace : le meilleur prince n’est pas celui qui est le plus vertueux, mais celui qui sait atteindre ses objectifs et qui assure ainsi la puissance de l’État et la prospérité de ses membres. Ce que Machiavel décrit répond en fait à une réalité bien ancrée : lorsque les enjeux sont trop importants, les responsables politiques n’hésitent pas à employer des moyens qui sont contraires au droit ou à la justice. C’est ce qu’on appelle la « raison d’État », comme si la fin (le bien de l’État) justifiait tous les moyens employés.
2. La politique ne peut s’affranchir de la morale
A. LE MEILLEUR POLITIQUE EST L’HOMME VERTUEUX
• L’efficacité n’est pas la seule qualité qu’on attend d’un responsable politique : aujourd’hui, on se préoccupe beaucoup de l’honnêteté, suite à de trop nombreuses affaires de corruption. Or, lorsqu’un dirigeant se montre capable d’employer les moyens les plus immoraux dans sa pratique du pouvoir, même si c’est en vue de l’intérêt général, on peut raisonnablement craindre qu’il fasse de même lorsqu’il s’agit de son intérêt personnel.
• Platon avait déjà montré, dans la République, que le politique a aussi une mission éducative auprès de son peuple. Il doit être exemplaire. Selon lui, la bonne politique et la vertu ne sont pas dissociables : le meilleur gouvernement est le gouvernement des meilleurs. Jugeant que c’est la vertu du dirigeant qui doit fonder son autorité, il en conclut que ce sont les philosophes qui devraient être rois.
B. LA POLITIQUE DOIT SE PLIER AU DROIT
• La morale énonce des règles relatives à la bonne manière de se comporter. Ces règles ont une valeur universelle et s’imposent donc à tout homme, quelle que soit la charge qu’il exerce. Selon Kant, nous connaissons toujours notre devoir car la conscience morale parle clairement (Critique de la raison pratique) : le problème, c’est précisément que nous sommes toujours tentés de faire des « exceptions ».
• La politique ne fait pas exception : à défaut d’être toujours animée par des intentions morales, elle doit au moins se plier aux exigences du droit. C’est ce qui définit l’État de droit : personne n’est au-dessus des lois, pas même les dirigeants et surtout pas eux, dans la mesure où ils risquent d’abuser de leur pouvoir si on n’y met pas des limites. C’est pourquoi, dans la droite ligne du libéralisme politique, Kant parle d’une politique qui « plie le genou » devant le droit (Vers la paix perpétuelle).
3. La justice n’est pas opposée à l’efficacité
A. L’EXEMPLE DES RELATIONS INTERNATIONALES
• Dans Vers la paix perpétuelle, Kant critique explicitement Machiavel en montrant que les préceptes qu’il donne entretiennent en réalité la situation à laquelle ils sont censés répondre : dans un contexte de méfiance réciproque, on est bien sûr tenté de mentir, de trahir avant d’être trahi, d’user de la ruse et de tous les moyens. Mais c’est un mauvais calcul car cela ne fait que renforcer la défiance entre les nations.
• L’oubli de la morale est donc la pire des politiques. Ce ne sont pas non plus les bonnes intentions qui sont susceptibles de faire progresser la paix : c’est là encore le droit (notamment le droit international), car il faut toujours une certaine dose de contrainte pour assurer le respect des règles posées. La meilleure politique sera donc celle qui se fera dans la transparence.
B. LE MEILLEUR RÉGIME EST LE PLUS JUSTE
• Dans certains régimes politiques tels que le despotisme, la morale est sans cesse bafouée : le tyran s’enrichit sur le dos de ses sujets, prend des décisions arbitraires, emprisonne et tue au gré de son caprice. Or on ne constate pas que ce genre de régime soit puissant sur la scène internationale : c’est au contraire la pauvreté et l’insécurité qui y règnent.
• Un régime républicain non seulement établit et respecte les droits fondamentaux des personnes, mais est aussi le plus propice à la prospérité et à la justice. Comme le dit Rousseau, une république est un État où la loi est l’expression de la volonté générale (Du contrat social) : c’est seulement dans un tel État que les citoyens acquièrent tranquillité, confiance en l’avenir, ce qui profite à tous.
Même si l’on s’en tient à l’efficacité, la meilleure des politiques n’est jamais celle qui méprise la morale. Il faut entendre par meilleur ce qui est le plus juste, car la justice a plus de valeur, et en dépit des apparences, ce qui est le plus juste s’avère souvent aussi le plus efficace. Mais la politique n’est pas seulement une question de morale, elle est surtout une affaire de droit.
Le Monde Mémorable

Le génie Chaplin
Personnalités, événements historiques, société… Testez votre culture générale

La fabrique de la loi
Boostez votre mémoire en 10 minutes par jour

Offrir Mémorable
Un cadeau ludique, intelligent et utile chaque jour

Culture générale
Approfondissez vos savoirs grâce à la richesse éditoriale du Monde

Mémorisation
Ancrez durablement vos acquis grâce aux révisions

Découvrez nos offres d’abonnements
Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.
Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois
Ce message s’affichera sur l’autre appareil.
Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.
Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).
Comment ne plus voir ce message ?
En cliquant sur « Continuer à lire ici » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.
Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?
Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.
Y a-t-il d’autres limites ?
Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.
Vous ignorez qui est l’autre personne ?
Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe .
Lecture restreinte
Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article
Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.

La philosophie morale
De l’importance de la philosophie morale en philosophie.
La Philosophie morale est une des branches majeures de la philosophie . La philosophie morale a trait à la philosophie pratique, alors que la métaphysique se rapporte à la philosophie théorique. La morale parle donc de l’action (et répond aux questions telles que “existe-t-il des guerres justes ? la peine de mort est-elle morale ?), certains se focalisant sur les intentions qui président aux actions, d’autres sur les conséquences des nos actions.
La philosophie morale tente ultimement de répondre à la question suivante posée par Kant dans la Critique de la raison pratique : Que dois-je faire ?
La morale et les mœurs
L’obligation morale.
“Je dois dire la vérité”, “tu ne tueras point” : l’exigence morale se présente à la conscience sous la forme impérative du devoir. Le verbe “devoir” n’exprime ici ni une nécessité psychologique ni une contrainte extérieure. L’obligation morale est la soumission à une loi que je m’impose à moi-même dans le dédoublement qui caractérise la conscience morale, ce “tribunal intérieur” que décrit Kant où l’être de désir que je suis est tenu en respect par cette autre partie raisonnable de moi-même.
La loi morale que je me donne à moi-même comme un sujet libre capable de retour réflexif sur soi-même, instaure une distance radicale entre ce qui est et ce qui doit être, entre ma nature empirique et ma propre raison. Bien et mal sont les concepts normatifs par lesquels s’exprime ce pouvoir de juger. Mais d’où vient-il ? Qu’est ce qui m’autorise à dire “c’est mal”, “c’est bien” ?
L’opinion commune confond souvent l’obligation morale avec l’obligation sociale, le système des règles en vigueur dans la société, les restrictions à notre liberté qui rendent la vie en commun possible. Les mots mos en latin et ethos en grec, d’où viennent les mots “morale” et “éthique”, signifie justement mœurs, coutumes.
On ne peut contester, il est vrai qu’il y ait une genèse empirique de la conscience morale. Pour un sociologue comme Emile Durkheim, elle se confond avec la conscience collective, ces manières de penser et d’agir que la société, “cette conscience de consciences” a créées en nous par l’éducation. Cela n’enlève rien à sa valeur, car l’individu tout seul ne saurait s’élever à ce degrés de la vie mentale que représente la moralité.
Mais si l’on analyse les mécanismes psychologiques de la mauvaise conscience, on peut montrer, comme le fait Freud, qu’elle relève d’un besoin de punition et n’est que le substitut inconscient chez l’adulte de l’angoisse du petit enfant qui craint, s’il désobéit, de perdre l’amour de ses parents. On peut même comme Nietzsche chercher l’origine du devoir dans ce log passé de cruauté dont témoigne l’histoire du châtiment.
Fonder la moralité
Mais cela suffit-il à rendre compte de l’exigence éthique ? Il faudrait alors réduire toute morale à un conformisme social et admettre la relativité des normes éthiques. “Le larcin, l’inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses”, disait Pascal dans les Pensées . Mais justement on ne peut confondre la coutume et cette forme supérieure de conscience par laquelle nous sommes capables de la juger et de la condamner.
L’éthique philosophique est la théorie morale conçue comme recherche des principes de l’action humaine, fondement des valeurs, parce qu’aucune détermination psychologique ou sociale ne peut nous dispenser de chercher ce qui absolument, c’est-à-dire non pas seulement pour moi comme sujet particulier qui recherche mon bien propre, ni non plus pour la collectivité réelle à laquelle j’appartiens, ma famille, ma classe sociale, ma communauté religieuse, mon pays, mais ce qui vaut universellement pour tout homme.
Le devoir moral n’est au fond que la forme de cette exigence : ce qui doit valoir pour moi doit valoir pour tout homme. Je suis donc l’auteur de cette loi que pose ma conscience, à laquelle j’adhère librement par ma volonté, et pourtant, comme loi, elle représente une universalité, une nature, à laquelle ma subjectivité particulière doit se souvenir nécessairement.

Les grandes orientations de la morale
Le bien ou le devoir.
L’habitude de définir l’exigence éthique par le devoir ( déon , en grec), c’est-à-dire par l’obéissance à une loi, caractérise la philosophie moderne. La question kantienne : “que dois-je faire ?” en est la forme par excellence et définit ce qu’on appelle les morales déontologiques. Dans l’Antiquité au contraire, la question morale est celle du but, de la fin ( télos , en grec) de la vie humaine. Cette fin s’appelle aussi le Bien.
Mais les morales antiques n’opposent pas comme nous le faisons le bien moral et les agréments de la vie. Ce sont des morales téléologiques. Pour les philosophes antiques, l’ensemble des biens auxquels tend la vie humaine est le bonheur, et l’état de perfection de la vie heureuse est le Souverain Bien. La vertu n’est pas faite de renoncement, elle est cette disposition à bien vivre que l’on acquiert par la connaissance philosophique.
Le problème essentiel de la philosophie est donc de déterminer quelle est la fin suprême de la vie humaine. Comme on le voit par exemple chez Aristote, cette fin est à la fois parfaite ( elle est l’activité de l’âme qui correspond à la nature propre de l’homme, la vie raisonnable), et complète ( elle n’exclut pas la recherche des autres fins de la vie. L’homme cherche à atteindre pour lui-même une perfection qui ne contrarie pas la nature, mais l’accomplit et où les prescriptions concernant le corps jouent un grand rôle. On peut parler avec Michel Foucault de “souci de soi”.
Moi, l’autre ou l’humanité
Le “souci de soi” qui caractérise les morales antiques est pourtant souvent solidaire d’un projet politique : la justice comme harmonie des parties de l’âme correspond à la justice dans la cité et l’amitié ( philia en grec) est l’idéal de communauté des sages.
Avec le christianisme, ce sont l’oubli de soi, le sacrifice pour l’autre qui définissent l’idéal éthique. Les morales de l’amour, de la charité, mais aussi toutes les morales fondées sur le sentiment, nous ont appris à ne pas faire à l’autre ce que l’on ne voudrait pas qu’on nous fît. Elles reposent sur le dévouement à autrui (altruisme), au prochain, ou sur l’identification à sa souffrance (pitié, bienveillance, compassion, sympathie).
Mais m’accorder aussi la valeur que j’accorde à tout autre homme : c’est le choix des morales de l’universel, de la valeur de la personne humaine en moi comme en tout homme, qui définissent aussi des devoirs envers soi-même.
Le cœur ou la raison
Il est tentent de dériver la moralité d’un sentiment innée, comme le fait Rousseau . La raison est avant tout la faculté de calculer, de raisonner, elle me compare aux autres et se met au service de mon propre amour, elle détermine mon intérêt et m’oppose aux autres. Comment pourrait-elle m’empêcher de faire du mal ? Pour être moral, il faut que je m’identifie à eux, que je souffre quand ils souffrent : cela ne peut venir que du cœur, de la voix de la nature ou de Dieu, de la conscience, quand elle n’a pas étouffée la vie sociale. D’ailleurs le remords, la culpabilité, la mauvaise ou la bonne conscience, l’amour du prochain, ne sont-ils pas des sentiments ?
Mais un sentiments peut-il être morale ? S’il nous pousse à faire le bien, n’est-ce pas que nous y sommes intéressés d’une quelconque manière ? L’égoïsme, le désir de ne pas souffrir nous mêmes s’y mêlent. Freud dira même que l’amour du prochain est une forme sublimée de la pulsion sexuelle. Un sentiment ne peut pas être un devoir parce qu’il ne se commande pas. Et peut-il avoir une valeur universelle ? A l’heure du business du cœur et de la charité, nous savons bien que nous sommes capables de nous émouvoir que pour les causes qui nous touchent ou qui nous concernent.
La télévision réussit parfois à faire vibrer la corde sensible en nous alors que nous restons indifférent à la détresse que nous côtoyons tous les jours ou à celle qui nous est présentée comme banale. Il faudrait alors, comme le fait Kant, fonder la morale non sur le cœur, mais sur la raison : le seul sentiment véritablement moral serait le respect que nous éprouvons pour la loi morale, il humilie notre nature sensible mais nous élève comme êtres raisonnables.
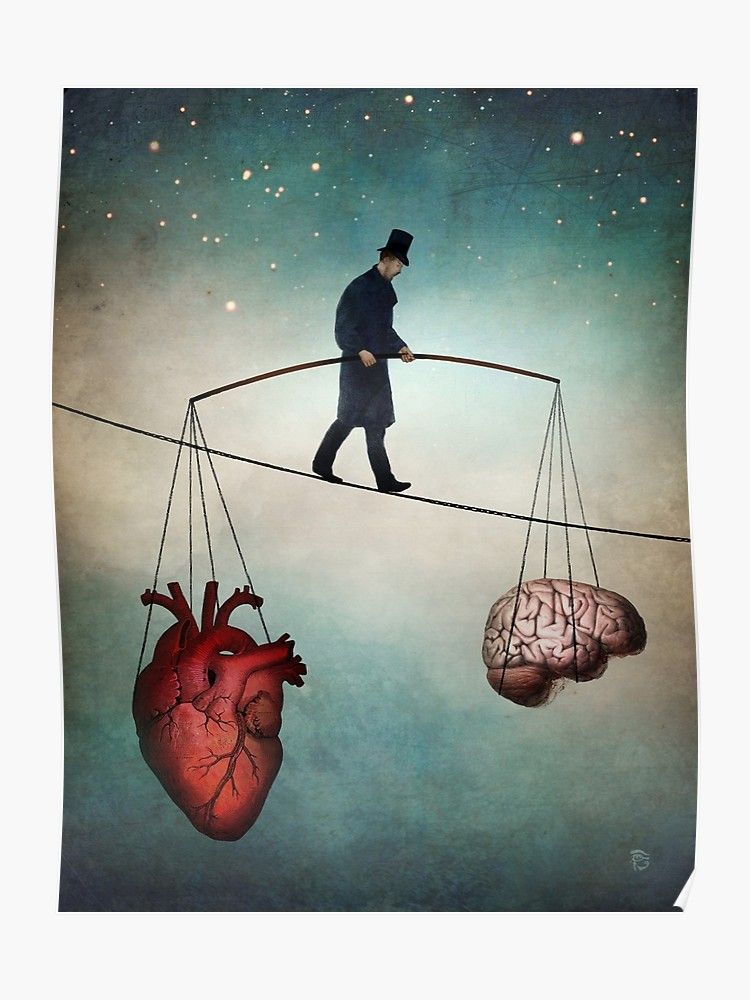
La volonté et les actes
La morale du devoir.
“De tous ce qu’il est possible de concevoir dans un monde et même généralement hors du monde, il n’est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n’est seulement une bonne volonté”, dit Kant dans Fondement de la métaphysique des mœurs . La volonté est bonne quand l’action a été accomplie par devoir, c’est à dire par pur respect pour la loi morale universelle et non par intérêt ou par inclination. Le marchand qui ne trompe pas l’enfant inexpérimenté sur le prix de ses articles peut agir ainsi uniquement pour conserver sa clientèle ; le philanthrope qui a un tempérament naturellement bienveillant peut ne faire le bien qu’en suivant son penchant : ils ne sont pas moraux même si leurs actes sont conformes au devoir.
A la différence des impératif hypothétiques qui sont de la forme : “si tu veux, alors tu dois…”, et qui ne nous commandent qu’en vue d’une fin particulière ou de la recherche du bonheur, l’impératif catégorique, la loi morale, nous commande sans condition, absolument : “Tu le peux parce que tu le dois”. Il est unique, car il se définit non pas par un contenu, une fin particulière, mais par la forme même de la loi qui devient le principe déterminant de la volonté : cette forme, c’est l’universalité. Si je peux universaliser la maxime de mon action sans me contredire, sans qu’elle rende contradictoire l’idée d’une nature humaine où tous les hommes feraient comme moi, alors j’agis par devoir.
La seule fin en soi susceptible de déterminer universellement la volonté est la personne humaine, considérée “toujours en même temps comme une fin, jamais seulement comme un moyen”. Elle n’a pas seulement du prix (on peut l’utiliser comme les choses, s’en servir comme l’implique la vie sociale), elle a en même temps une dignité, elle mérite le respect, ce qui condamne toute condition ou attitude qui la dégraderait.
A l’hétéronomie d’une volonté déterminée par des mobiles empiriques, la loi morale substitue l’autonomie de la volonté, son pouvoir d’être à elle même sa loi, d’instituer une législation qui vaille pour tout être raisonnable. Kant appelle cette communauté idéale d’être raisonnables “le règne des fins”.
Ethique de conviction et éthique de responsabilité
Mais le formalisme kantien suffit-il à déterminer le contenu de l’action ? Peut-on faire l’économie des conséquences de nos actes pour définir la moralité ? Certes, le rigorisme kantien n’est pas la casuistique que Pascal caricaturait dans les Provinciales , cet examen de cas de consciences qui finit toujours par trouver une bonne intention aux actes immoraux.
Pour Kant, il faut à la fois que l’acte soit bon et que l’intention le soit. Mais le principe formel du devoir exclut de prendre en compte les conséquences de nos actions, bonnes ou mauvaises. Benjamin Constant objecte à Kant l’exemple d’un homme qui considérerait comme un crime de mentir même s’il s’agissait de cacher à des assassins, que son ami qu’ils poursuivent s’est réfugié dans sa maison. Kant lui répond que la responsabilité morale considère que le mensonge “nuit toujours à autrui : même si ce n’est pas à un autre homme, c’est à l’humanité en général, puisqu’il disqualifie la source du droit”.
Mais quand les circonstances m’imposent de choisir entre sauver la mère et sauver l’enfant, entre l’intérêt de sauver le vieillard agonisant et celui du jeune père de famille bien portant puis-je en conscience ne pas choisir ? Pourtant, n’ont-ils pas tous la même dignité et les mêmes droits ? Comment en conscience pourrai-je choisir ? L’éthique de conviction nous impose de ne pas tenir compte des circonstances mais seulement de l’idée pure du devoir. L’éthique de responsabilité nous impose d’intégrer à l’exigence éthique de la représentation des conséquences prévisibles de nos actes.
A l’opposé de la morale kantienne du devoir, les philosophes utilitaristes anglais comme Bentham ou Stuart Mill ont fait du bonheur du plus grand nombre et de l’intérêt commun le principe de la moralité. Le calcul de la quantité et de la qualité des plaisirs et l’harmonie entre les intérêts individuels et le bonheur commun constituent les seuls critères d’évaluation.
L’universel en question et l’homme-dieu
Aucune morale générale ne permet de résoudre un conflit de devoir : tuer pour lutter contre l’oppression ou ne pas tuer et être complice de l’oppression, comment trancher ? Pour Sartre, le sens de nos actes n’est pas fixé d’avance par des règles a priori . L’homme invente par ses actes des valeurs : en se choisissant, il choisit l’homme.
Si Dieu n’existe pas, “tout est permis”. Le matérialisme athée que redoutait Dostoïevski et qu’il mettait dans la bouche d’Ivan Karamazov semble bien avoir ouvert cette nouvelle époque de “l’homme-dieu”. Pas une époque sans morale ni religion, mais un trop-plein de morales. Entre le relativisme, l’utilitarisme des sociétés libérales, l’humanisme rationaliste, les morales de l’amour et du cœur, il faut choisir.
C’est à chaque homme de fonder l’exigence morale : il ne la trouve pas toute faite. Quel autre recours que la pensée, dit Hannah Arendt dans Considérations morales , aurions-nous pour juger des cas particuliers quand nous ne disposons d’aucune règle préétablie pour dire “c’est bien”, “c’est mal”, que les cartes sont sur la table et qu’il faut prévenir des catastrophes.

La difficulté de penser vient de ce qu’il se présente comme une obligation qui s’impose à nous sous la forme de règles générales qui doivent valoir pour tous les hommes et qui doit être librement choisie par chacun de nous. On ne peut se contenter de réduire cette exigence à la pression que la société exerce sur nous. Mais la tentation philosophique pour trouver en l’homme un fondement universel de moralité soulève aussi bien des difficultés. Il reste que le devoir, quels que soient sa forme et son contenu, exprime la nature de l’homme comme être qui ne se contente pas d’accepter en lui le donné naturel ou social, et s’efforce de construire librement son humanité.
Philosophie morale ou Philosophie éthique ?
Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la première renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde renvoie elle aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.
Chez certains penseurs, la philosophie éthique est une philosophie dérivée de l’ontologie ( Platon, Sartre ), chez d’autres dérivée de la politique ( Aristote ). Certains inversent même le rapport théorique / pratique : la philosophie morale est la philosophie première ( Lévinas ), c’est d’elle que doit découler les autres branches de la philosophie.
L’origine de la morale :
Il y a deux manières d’envisager la source de la morale :
– la théorie hétéronome de la morale : l’homme reçoit la morale d’ailleurs qui de lui-même (Dieu, la loi morale, la société). C’est la position de Saint-Thomas, Kant ( Critique de la Raison Pratique ), Schopenhauer, Bergson ou encore Durkheim .
– la théorie autonome de la morale : l’homme crée, invente lui-même les principes de son action ( Nietzsche, Sartre, Camus )
Courants de la philosophie morale :
Voici une brève présentation des principales branches de la philosophie morale, depuis l’Antiquité à nos jours.
– Formalisme ou Déontologisme : La philosophie pratique de Kant se rattache à ce courant. Le formalisme affirme que la morale d’un acte dépend de la forme de l’acte, et non de son contenu.
– Individualisme : L’individualisme, en moral, pose la primauté de l’individu sur la totalité sociale : les valeurs émanent de l’individu. Nietzsche ou Dumont sont des représentants de l’individualisme moral.
– Eudémonisme : Selon l’eudémonisme, le but de l’action est la recherche du bonheur.
– Pessimisme : Le pessimisme, en moral, consiste à penser le mal l’emporte sur le bien, l’homme est donc condamner à mal agir.
– Utilitarisme : L’utilité doit être le critère de l’action. Selon les utilitaristes, le principe d’utilité suppose une recherche calculée des plaisirs (arithmétique des plaisirs). A la fois en termes quantitatifs et qualitatifs.
– Hédonisme : Le bonheur est le plaisir immédiat. Le bonheur est jouissance.
– Stoïcisme : C’est le concept de destin (fatum) qui régit la morale des stoïciens. Les actions de l’homme doivent être guidées par l’acceptation du destin. L’homme ne maîtrisant que son regard sur les choses, et non les choses elles-mêmes.
– Épicurisme : La morale épicurienne consiste à ne satisfaire que les plaisirs naturels et nécessaires.
– Conséquentialisme : Seules les conséquences d’un acte permettent de le qualifier en termes de moral ou d’immoral.
– Cynisme : Le cynisme consiste à mépriser la morale, les conventions ou encore les traditions.
– Relativisme éthique : Le relativiste considère qu’aucune morale ne peut prétendre à l’universel, que les cultures ont une morale propre, équivalente les unes aux autres.
– Altruisme : L’altruisme affirme que seuls sont moraux les actes guidés par le désintéressement et l’amour d’autrui.
– Nihilisme : Le nihilisme défend une conception selon laquelle il n’existe pas d’absolu, de morale transcendante.
– Existentialisme : L’homme invente son chemin et sa morale librement. Le salaud, au contraire, guidé par l’esprit de sérieux, se cache derrière une morale héritée.
10 Philosophes majeurs de la morale et leur œuvre morale principale :
– Platon : C’est dans le Gorgias de Platon que sa philosophie morale s’illustre le mieux, même si la République présente également les principaux concepts de la philosophie morale platonicienne.
– Aristote : Ethique à Nicomaque
– Rousseau : De l’origine des inégalités parmi les hommes
– Kant : Métaphysique des Mœurs
– Hume : Traité sur la Nature Humaine
– Nietzsche : La Généalogie de la morale
– Schopenhauer : Aphorismes sur la sagesse (très facile à lire)
– Spinoza : Éthique
– Sartre : L’existentialisme est un humanisme (très facile à lire)
– Lévinas : Totalité et Infini ( ouvrage difficile pour les néophytes)
Nos articles de Philosophie morale & éthique :
Kant et le bonheur.
Kant : Une anti-philosophie du bonheur Le bonheur chez les Grecs La tradition philosophique, depuis Aristote, a associé bonheur et vie contemplative. Le bonheur se différencie du divertissement…
Sénèque : La Vie Heureuse
De la Vie Heureuse (Analyse) De La Vie Heureuse est un texte de Sénèque, philosophe romain de l’école stoïque. Dans cette œuvre, Sénèque tente de définir ce qu’est le bonheur et par quel moyen l’homme peut y parvenir…
Nietzsche et la morale
Après l’article sur la mort de Dieu chez Nietzsche et son invitation à devenir ce qu’on l’on est, penchons nous sur la morale défendue par le philosophe allemand. Dieu et la morale des esclaves…
Le philosophe Alain : Bonheur, Morale et Liberté
Le philosophe Alain (1868-1951), de son vrai nom Emile Chartier, est l’auteur des fameux: – Propos (1908-1919) – Système des beaux-arts (1920) – Propos sur le bonheur (1928) – Idées (1932) – Eléments de philosophie (revus en 1940)…
Hans Jonas : Le Principe Responsabilité
L’Humanité à venir a-t-elle des droits ? Par Laurence Hansen-Love Laurence Hansen-Love, plume renommée de la philosophie, éditrice, auteur de nombreux ouvrages et blogueuse influente…
Socrate : Nul n’est méchant volontairement
Rousseau : l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt.
Rousseau et la bonté de l’homme : Une philosophie de la Nature La philosophie de Jean-Jacques Rousseau constitue un immense édifice moral et politique. Depuis l’Emile jusqu’au Contrat Social …
You may also like

La philosophie de Saint Thomas D’Aquin
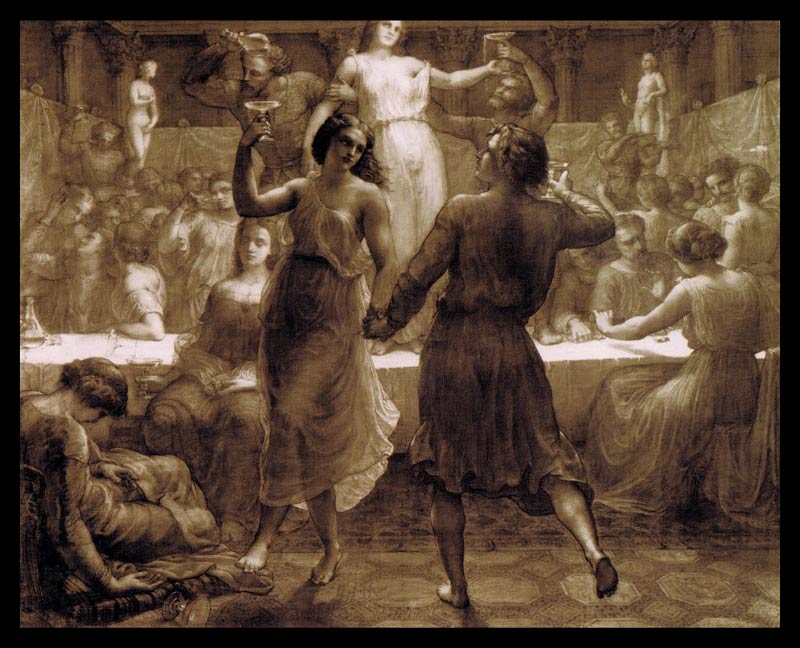
L’amour chez Platon
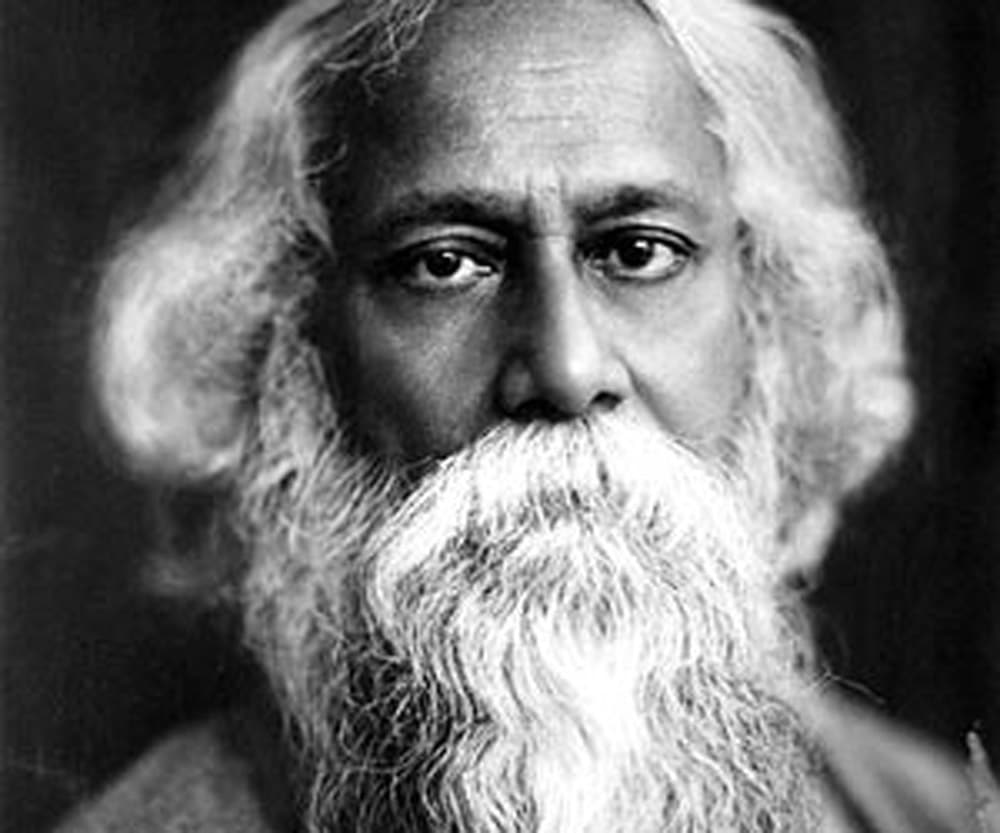
La philosophie indienne
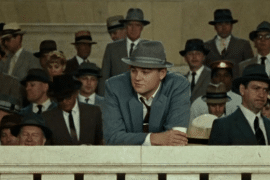
La vie est une marge (Tribune)

Code Promo Fnac Livres 2022

Apologie de Socrate de Platon
29 Comments
- Ping : Eudémonisme - FAQ
- Ping : Le philosophe Alain : Bonheur, Morale et Liberté
- Ping : Le Visage chez Levinas
- Ping : Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas
- Ping : Kant : Fondements de la Métaphysique des moeurs
- Ping : Aristote : L'Ethique à Nicomaque
- Ping : Peter Sloterdijk et l'eugénisme : Régles pour le parc humain
- Ping : Critique de la Raison Pratique de Kant
- Ping : Nietzsche : Généalogie de la morale
- Ping : L’autonomie chez Kant
- Ping : L'amour - Définition Philosophique
- Ping : Citations de Vauvenargues
- Ping : Citations de Marc-Aurèle
- Ping : Citations de Bentham (Jeremy)
- Ping : Hans Jonas : Le Principe Responsabilité
“Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la seconde renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde fait plus référence aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.”
La seconde renvoie, La seconde fait reference, Et la premiere elle sert a quoi ?
Merci, l’article a été corrigé pour plus de clarté sur ce point
L’article n’a toujours pas été corrigé…..
Deux “seconde” ne peuvent coïncider, il faut trancher. Dans votre texte, elles doivent se succéder.
“Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la seconde renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde renvoie elle aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.”
Merci pour votre site stimulant.
Sorry, j’arrive en second sur le sujet.
Ma contribution ne s’inscrit pas dans le sillage d’un commentaire complementaire, mais plutôt d’un souci de clarification. Il s’agit de la difference à établir entre l’ethique et la morale. Mieux la primauté de l’une sur l’autre
Félicitations pour votre très bon site! Juste ceci, pour l’instant. Sur la page http://la-philosophie.com/philosophie-morale, serait-ce plutôt:
“Philosophie morale ou Philosophie éthique ? Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la PREMIÈRE renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde renvoie elle aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.”
plutôt que ce qu’on y lit (Si la seconde…)? Continuez votre très bon travail! Mes sentiments les plus distingués
- Ping : Philosophie morale à l’école du Père M-D Philippe | Juriste d'Etat – Droit Public
parlant du relativisme morale je dirai que ça a sa raison suffisante d’être .Que de parler d’un acte ou d’une action morale de manière universelle c’est erroné la conception philosophique de la morale. d’avis avec Blaise Pascal, Prothagoras: il n’y a aucune vérité existante de façon universelle car elle est portée aux jugements subjectifs pour ce qui est de sa valeur. alors Morale=Manière propre à un individu.
Salut, je me rencontre face à un professeur qui intitule son cours : “Philosophie morale ou éthique philosophique”. Mais là j’ai du mal à gommer les deux termes au même pieds d’égalité !
Je voudrais savoir les nuances relatives à chaque concert pour placer chacun à sa place, sinon ça créé confusion…
Merci avant tout pour ce site passionnant! Je suis malheureusement sensible aux fautes d’orthographe et de syntaxe? Disposez vous de correcteurs ou correctrices? J’aimerais pour vous que la qualité du fond soit mise en valeur par la qualité de la forme.
En tout cas je vous lirai toujours tellement vos publications sont intéressantes.
Bonjour Christian ! Merci de votre question et de l’intérêt que vous portez à nos publications. Je vous parle en tant que chargé de la communication. Notre groupe éditorial est très réduit pour le moment, mais cela changera certainement bientôt. Je suis tout aussi sensible que vous aux fautes d’orthographe (même si j’en fait moi-même souvent, je dois bien l’avouer). Si vous souhaitez investir un peu de votre temps en tant que correcteur/éditeur, je crois pouvoir vous dire que nous en serions honoré.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.
Dictionnaire de philosophie en ligne
Comment rédiger une introduction de dissertation
Comment rédiger son intro de dissertation de philosophie ? Quelles sont les étapes obligatoires ? Celles facultatives ? Et quand vaut-il mieux l’écrire ? On fait le point sur la méthode de l’introduction.

L’introduction est le premier contact avec le lecteur ou la lectrice. C’est un moment important, qui montre déjà si vous maîtrisez la méthode. Un correcteur ou une correctrice connaît à peu près votre note rien qu’en lisant l’introduction. Autant ne pas la bâcler !
Une introduction est toujours structurée en 3 ou 4 étapes :
- Accroche (facultative)
- Définition des termes du sujet
- Énoncé de la problématique
- Annonce de plan
La personne qui corrige va chercher ces étapes dans votre texte. Si elle n’y parvient pas, c’est que votre introduction est confuse ou manque de structure. Il faut donc être le plus clair possible. Une bonne idée est de revenir à la ligne à chaque nouvelle étape. Vous indiquez ainsi visuellement le changement et aidez à suivre votre pensée.
Étape 1 : l’accroche
Article détaillé → Faire une accroche
C’est une étape facultative. Elle consiste à prendre un élément “accrocheur” pour capter l’attention du lecteur ou de la lectrice. On part de quelque chose “hors philosophie” (fait historique, événement récent, fiction, etc.) et on amène vers le sujet. L’idée est de ne pas démarrer trop sèchement, directement en donnant la définition des termes du sujet.
Étape 2 : définir les termes
Article détaillé → Définir les termes
Il s’agit d’expliciter le sens qu’on donne aux mots du sujet. Fournir des définitions permet d’être d’accord sur “de quoi on parle” et évite les malentendus. Pensez à un sujet sur la morale : il vaut mieux définir la morale dès le départ, sinon on risque de ne pas se comprendre.
Étape 3 : poser la problématique
Articles détaillés → Comment trouver la problématique ? + Poser la problématique
La définition des termes fait apparaître un problème intellectuel, un paradoxe. C’est ce qu’on appelle la problématique. L’introduction doit expliquer clairement quel est ce problème. Il ne s’agit pas juste de poser une question, mais de montrer que quelque chose “ne fonctionne pas” avec les définitions.
C’est une étape cruciale de la copie. Si vous n’identifiez pas de problème, vous n’avez pas de raison d’écrire de dissertation. En réalité, toute votre dissertation est un essai pour solutionner ce problème. Vous devez donc être très pédagogique.
Étape 4 : annoncer le plan
Article détaillé → L’annonce de plan
Une fois le problème présenté, on déroule les étapes de sa résolution. C’est-à-dire le plan. Annoncer le plan montre que vous savez où vous allez et donne une idée de la progression que vous allez suivre. En pratique, il s’agit de faire 3 phrases qui décrivent rapidement le contenu de vos 3 parties.
Certains enseignants préfèrent du suspense ( sic ) et disent que l’annonce de plan est facultative. D’autres affirment l’inverse : “S’il n’y a pas d’annonce de plan, c’est qu’il n’y a pas de plan”. Pour être prudent mieux vaut toujours annoncer son plan.
Et après l’intro ?
Article détaillé → Faire une sous-partie
Une fois l’introduction rédigée, vous allez écrire votre développement. Il se compose souvent de 3 grandes parties , qui contiennent chacune 3 sous-parties. Chaque sous-partie doit affirmer une idée et donner une raison d’accepter cette idée.
Quand rédiger l’introduction ?
L’introduction peut se rédiger avant d’écrire le développement, ou bien à l’inverse après l’avoir écrit. Chaque option à ses avantages et ses inconvénients. Rédiger l’introduction en premier suppose davantage de maîtrise, mais donne souvent un résultat plus convaincant. L’écrire après le développement permet de rattraper des erreurs, mais ne garantit pas de sauver la copie.
On peut aussi écrire les définitions et la problématique d’abord, et compléter l’annonce de plan une fois la copie entièrement rédigée. Cela permet d’avoir une idée nette de la problématique et du sens des mots, sans obliger à suivre un plan qu’on n’a pas complètement prévu.
Crédit photo : Cosmos Pencil Tablet Paper par Calsidyrose (CC-BY).
Dernière modification :
Publication initiale :
Dicophilo soutient ces associations et projets :
- Zero Waste France , pour réduire notre impact écologique
- Framasoft , pour dégoogliser Internet
- L’éthique minimale de Ruwen Ogien
- La Quadrature du Net , pour nos libertés numériques
Ces liens sont mis là gratuitement.
Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée
Catégorie : La morale

Est-ce à la justice de dire où est le mal ?
La question de départager le bien et le mal est un débat vieux comme la philosophie elle-même. Ce dilemme, « Est-ce à la justice de dire où est le mal ? », révèle l’interaction entre les notions éthiques et juridiques, concept central à notre coexistence sociale.
- Dissertations

Au nom de quoi peut-on reprocher à autrui d’être égoïste ?
La dissertation qui suit interroge le principe de la critique d’égoïsme. Autrement dit, elle se demande sur quelle base, quel principe ou quelle morale, une personne peut adresser à une autre le reproche d’être égoïste.

Agir moralement, est-ce nécessairement lutter contre ses désirs ?
La question de l’articulation entre morale et désir soulève un vaste débat. Agir moralement, implique-t-il forcément une opposition à nos désirs ? Cette dissertation tentera d’éclaircir ce sujet complexe, en analysant diverses perspectives philosophiques.

A quelles conditions un acte est-il moral ?
Aborder la question morale se révèle complexe : à quelles conditions un acte est-il moral ? S’interroger sur cela conduit à examiner notre compréhension de la moralité, ses fondements et ses implications, tout en se situant dans le cadre de diverses théories éthiques.

Avoir bonne conscience, est-ce un signe suffisant de moralité ?
La dissertation philosophique traitera du thème de la bonne conscience en relation avec la moralité. Le sujet nous invite à questionner les liens entre conscience morale personnelle et les standards universels de justesse et d’intégrité.
- La conscience
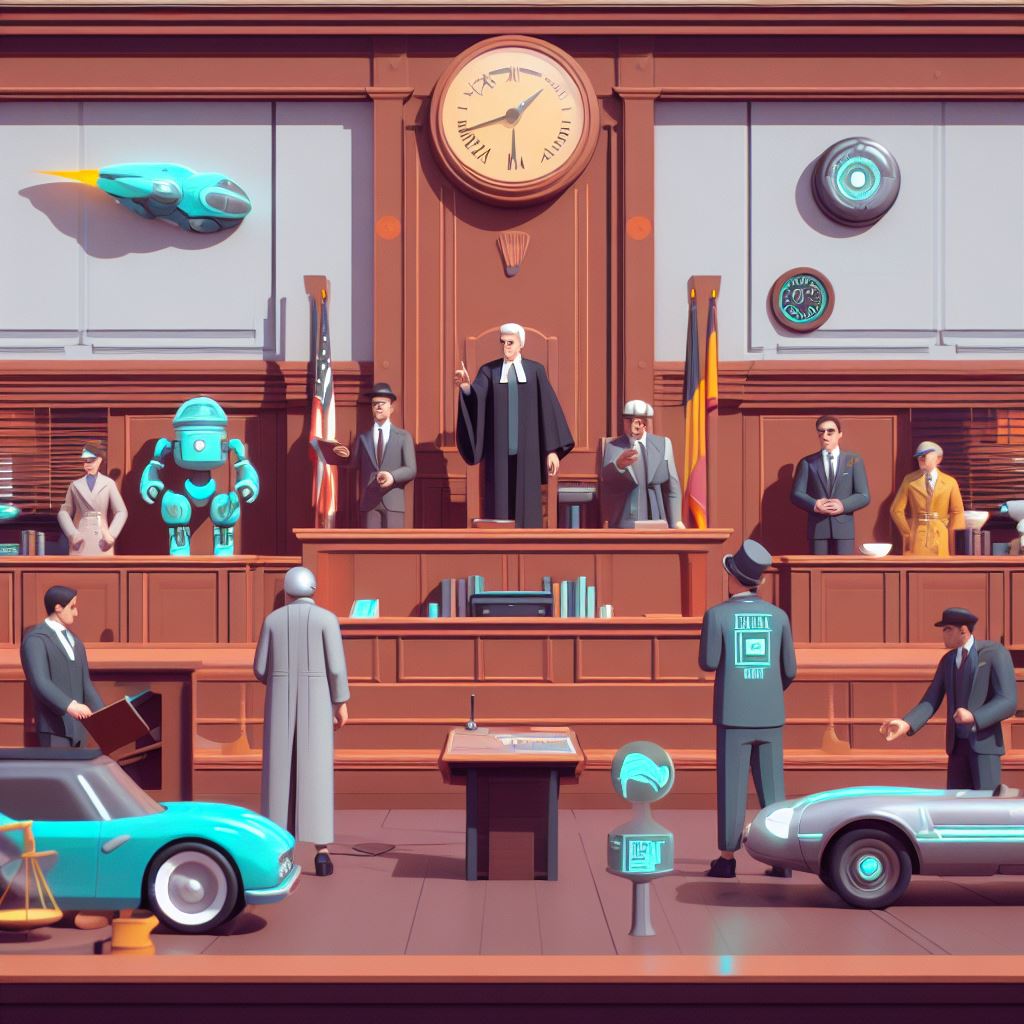

Le droit peut-il être indépendant de la morale ?
Cette dissertation explore la question de l’indépendance du droit par rapport à la morale. Elle questionne si le droit, en tant que système de règles, peut exister et fonctionner sans être influencé ou guidé par des principes moraux.
La morale a-t-elle un rôle à jouer dans les sciences ?
C'est un corrigé avec le plan, quelques pistes a suivre. Facile à comprendre, il m'a valu d'avoir un 16.
I. L'analyse du sujet
Le terme "morale" peut être considéré sous différents angles. Il peut s'agir des exigences morales dont est porteur le savant au même titre que n'importe quel autre être vivant en société.
Il peut aussi s'agir de la déontologie - i.e. de l'ensemble des règles et des valeurs qui guident sa conduite - dans le domaine de recherche qui est le sien. Bien sûr les deux sens sont reliés car il parait difficile de couper le second du premier mais il ne faut pas ignorer que le savant se trouve confronté à des responsabilités spécifiques. Le savant peut-il se contenter de dire "je m'occupe de ma recherche et rien d'autre ?" Toute vérité est-elle bonne à divulguer ? Ne peut-il pas aussi à l'occasion prévoir quels usages peuvent être faits de ses découvertes ?
Peut-il se voir, dans ces conditions, attribuer une responsabilité lorsque des conséquences indésirables découlent de ses travaux ? Comment doit-il réagir lorsque ses travaux sont financés par des institutions dont les finalités n'ont rien de scientifique ?
Doit-il accepter le rôle d'expert que les politiques et parfois certains intérêts privés veulent lui faire jouer ?
La science moderne s'est constituée à partir du XVIIe siècle autour de l'idée de publicité des raisons : en opposition à l'alchimiste qui officie en secret pour des initiés, le savant moderne expérimente, publie ses résultats et livre ses arguments à l'examen et à la discussion.
La conséquence de ceci est que ces résultats deviennent exploitables à des fins étrangères aux buts de la science : économiques, militaires etc.
En étant publiés les travaux scientifiques sortent du cercle des gens qui y sont scientifiquement intéressés.
Ceci est d'autant plus vrai que la recherche est financée soit par l'Etat (comme le souhaitait déjà BACON) soit par des fondations privées qui sont aussi soucieuses de récupérer le fruit de leur investissement.
Se pose donc la question de l'articulation entre science et technique.
On appelle aujourd'hui "technique" une pratique rationnelle, en fait une pratique fondée sur l'application de connaissances scientifiques.
Le savant peut-il être tenu pour responsable des utilisations technologiques de son travail ? Doit-il leur être indifférent ? Peut-il s'en tenir à une éthique de la recherche de la vérité sans aucune autre considération
II. Développement
A. Science et technique
Le caractère public de la recherche scientifique (publicité des raisons, voire du financement) entraîne des conséquences étrangères au travail scientifique lui même.
L'exploitation technique des résultats de la science appartient aux politiques ou à des intérêts privés. Cette exploitation entraine des conséquences qui ne sont pas voulues par le savant ni même parfois par ses promoteurs eux-mêmes (cf : notion de risque technologique).
Quelle attitude le savant doit-il adopter face à cela ? Doit-il considérer que l'exploitation de ses résultats ne lui appartient plus et que sa seule tâche est la recherche de la vérité ?
Dans ces conditions, le savant pourrait se contenter d'une déontologie au sens strict c'est à dire de règles régissant ses relations avec ses pairs : il pourrait alors se sentir quitte en observant des régles d'honnêteté intellectuelle, en ne s'attribuant pas des vérités trouvées par d'autres etc...
La question est de savoir si le savant peut sans remords abandonner à d'autres l'exploitation pratique de son travail. Ceci est d'autant plus vrai que l'on s'attache aux sciences appliquées, mais la recherche fondamentale n'échappe pas non plus à cette question. Il suffit de penser par exemple à l'utilisation militaire de la recherche nucléaire.
B - Les fondements de la relation science/technique
Ceci nous amène, sur un plan plus ontologique, à repérer certains enjeux fondamentaux de la relation science/technique : si on attribue une responsabilité au savant, au delà du respect des règles élémentaires du travail scientifique, c'est parce que la science produit des phénomènes que la nature, livrée à elle-même ne produirait pas. Ces phénomènes peuvent être tenus pour naturels (en ceci qu'ils suivent une loi de la nature) ; mais ce sont aussi des artifices en ceci que ce sont de purs produits du travail de laboratoire. Comme l'avait bien vu HANNAH ARENDT, les frontières du naturel et de l'artificiel sont ainsi brouillées à mesure que la science démultiplie nos possibilités d'action sur la nature. Par ce fait même, le savant se trouve "engagé" socialement et ontologiquement, plus qu'il ne le voudrait peut-être, ceci conduisant à détruire la fiction d'une autonomie absolue du champ scientifique. Mais n'impute donc-t-on pas au savant dans ces conditions des conséquences qu'il n'a à aucun moment voulues ? Et ceci n'est-il pas de nature à inhiber le travail de la recherche ?
C - Déontologie du savant et morale du citoyen
Il convient alors de distinguer entre le point de vue du citoyen (que le savant occupe comme n'importe lequel de ses contemporains et y compris par rapport à ses propres actes) et la logique propre à l'investigation scientifique.)
Lorsque le savant proteste contre telle ou telle exploitation technique faite du travail scientifique, c'est en tant que citoyen qu'il intervient, même si son travail scientifique lui donne précisément des moyens de jugement que n'a pas forcément le citoyen de l'espèce ordinaire. C'est alors en tant qu'expert qu'il intervient. Mais c'est moins d'une morale propre à la science qu'il s'agit que d'une attitude morale du savant en tant que citoyen. Reste que cette attitude peut entrer en conflit avec les régles scientifiques de divulgation et de publication, en particulier si l'intéressé anticipe certaines conséquences indésirables de son travail. Doit-il alors pratiquer la rétention d'information (en violation des règles professionnelles et peut-être contre son intérêt de carrière) ? Doit-il au contraire borner son action de citoyen à une mise en garde ?
Références utiles
WEBER : le savant et le politique ARENDT : la crise de la culture (en particulier le chapitre sur le concept d'histoire)
Corrigés liés disponibles
Les corrigés similaires disponibles
- La philosophie a-t-elle sa place dans un monde dominé par la science ?
- Bergson, Les Deux Sources de la morale: Le moi social
- Laclos, Les Liaisons dangereuses - Lettre 161: « Être cruel »
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro - Acte III, scène 5
- La religion rassemble-t-elle ou divise-t-elle les hommes ?
Proposez votre corrigé pour ce sujet

- Philosophie
Philosophie : comment réussir l’introduction de la dissertation ?
- Julien Lagalle
- 17 Juin 2024
À lire dans cet article :

La dissertation en philosophie est souvent la bête noire des élèves en classe de terminale et notamment son introduction. Comment la construire ? Quels éléments doivent y figurer ? Comment formuler la problématique ? Comment annoncer la problématique ? Des questions très légitimes auxquelles nous répondons sans plus tarder.
L’introduction de la dissertation de philosophie en terminale répond à certaines contraintes de forme qu’il faut savoir maîtriser. Nous te proposons de les parcourir, avec quelques astuces qui te permettront de perfectionner tes copies.
La structure de l’introduction de dissertation de philosophie
Avant même de commencer cet article, revenons sur un point essentiel : la structure de l’introduction de dissertation de philosophie . Nous parlons ici de philosophie, mais sache que ces quelques éléments sont valables pour n’importe laquelle de tes dissertations (dissertation de français, HGGSP, SES, etc.).
Ce que tu dois retenir à tout prix : l’introduction contient idéalement six moments, listés ci-dessous :
L’énoncé du sujet
- L’analyse des termes
- La problématisation du sujet
- La problématique
L’annonce du plan
Par ailleurs, nous avons également rédigé des articles pour t’aider à réussir ton plan de dissertation, ton développement et ta conclusion , n’hésite pas à y jeter un petit coup d’œil.
L’accroche de la dissertation de philosophie
L’accroche est constituée d’une ou deux phrases qui vont capter l’attention du lecteur, voire son intérêt, le conduire jusqu’à l’énonciation du sujet, et adoucir le début de ta dissertation, qui pourrait paraître trop abrupte si tu commences directement par l’énoncé du sujet. Cependant, l’accroche n’est pas nécessaire : si tu n’en trouves pas, pas de panique ! Le correcteur ne t’en tiendra pas nécessairement rigueur.
L’accroche de ton introduction repose en général sur un fait historique ou une référence littéraire, mais d’autres références peuvent être convoquées ; veille seulement à ce que l’amorce puisse être raccrochée facilement au sujet, à ce qu’elle s’intègre dans la culture générale (pas de référence trop récente, si possible), et à ce que ce ne soit pas une citation philosophique, ce qui restreindrait le sujet à une seule approche : le but est, au contraire, d’ouvrir le sujet, d’y conduire ton lecteur sans le confronter d’emblée à une seule perspective. Et petit conseil, ne commence jamais une copie par « de tous temps, les hommes », ni quoi que ce soit de similaire : l’accroche doit être incisive, pas générale.
L’accroche de ton introduction doit te conduire à énoncer le sujet, comme s’il était (presque) naturellement apporté par l’amorce. Idéalement, le lecteur doit se sentir amené de façon fluide jusqu’au sujet. L’énoncé doit être dans les mots exacts du libellé, ou le plus possible ; à ce stade, ne t’autorise pas encore de reformulation du sujet.
L’analyse des termes du sujet
L’analyse des termes est l’étape la plus longue de l’introduction, et elle est cruciale en ce qu’elle doit montrer l’épaisseur du sujet ; pour cela, tu dois reprendre les termes saillants du sujet pour en expliciter la signification , sachant que certains termes pourront recevoir différentes définitions concurrentes, ce qui orientera ton traitement du sujet. Idéalement, tu auras vu la plupart des définitions des termes, qui correspondront à des notions ou des thèmes du programme. Tu ne devras probablement pas définir chaque terme, mais ta préparation le long de l’année te permettra de repérer les points saillants du sujet, sur lesquels ton analyse devra s’appesantir.
En outre, les définitions que tu donneras seront des esquisses, des définitions préalables, afin de ne pas empiéter sur le véritable travail de pensée que tu mettras en place dans le corps de ta dissertation. Ne définis donc pas tous les termes, au risque de passer trop de temps sur cette étape, mais tu peux t’autoriser des remarques en fonction de la singularité du sujet. Là encore, n’impose pas des lectures, mais ouvre des pistes.
Lire aussi : La morale sociale chez Bergson
La problématisation de la dissertation de philosophie
Ce sont ces pistes que tu dois désormais rassembler dans l’étape de la problématisation. Cette étape est assez difficile, mais elle est cruciale, et permet de mieux comprendre ce que l’on entend ensuite par « problématique », la clé d’une introduction.
La problématisation, c’est le moment où ton analyse se condense en un problème central que tu auras isolé à partir du sujet. La problématisation consiste, si elle est bien menée, à montrer qu’une tension est née de l’analyse des termes du sujet, parce que certains termes semblaient se contredire, ou parce qu’un terme a deux définitions divergentes, ou parce que le sujet lui-même semble exhiber une tension interne.
C’est cela que tu dois montrer : tu ne peux pas passer d’un coup de l’analyse des termes à la problématique, mais tu dois montrer en quoi un problème se pose à partir de l’analyse, problème que tu formuleras ensuite dans la problématique. La problématisation permet ainsi de ne pas paraphraser le sujet : là où le sujet est une simple question, la problématisation conduit à exhiber la tension que tu as découverte dans le sujet, et à la formuler dans la problématique.
Une façon simple de problématiser est de faire voir que, non seulement, on peut répondre à la question du sujet par oui et par non, mais que le oui ne suffit pas, parce qu’il prête le flanc à un contre-argument, et réciproquement. Le problème, c’est l’expression de cette insuffisance de chaque réponse, c’est-à-dire aussi de la difficulté du sujet. C’est aussi le lieu de dégager les enjeux du sujet, c’est-à-dire son importance : en une phrase, dire en quoi les conséquences du problème ont des répercussions sur notre vie.
Lire aussi : Faire son devoir, est-ce renoncer à sa liberté ?
La problématique de la dissertation de philosophie
C’est une étape très courte, en une phrase, mais cruciale, puisque c’est elle qui orientera tout le reste de ton développement. Encore une fois, la problématique ne doit pas être une paraphrase du sujet, mais doit être la formulation d’un problème que tu as découvert à l’intérieur du sujet. Dans « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? » (sujet du baccalauréat 2015) par exemple, le problème par excellence est celui de ma liberté vis-à-vis de mon passé : mon passé me détermine, puisqu’il est tout ce que je suis jusqu’à présent, et, en même temps, parce qu’il est mon passé et non pas mon présent, j’en suis fondamentalement libre – il y a là tension, voire contradiction, et donc problème.
C’est cela que la problématique doit formuler. La problématique doit consister en une question. Ne prends pas le risque de poser une cascade de questions dont le correcteur ne comprendrait pas le lien, ni celui de formuler ta problématique sous la forme d’une affirmation.
Une fois que la problématique a été formulée, tu peux annoncer le plan selon lequel tu comptes traiter le problème. Le plan doit être en trois parties : cela fait partie des attendus de forme. Ces parties ne doivent pas être des questions, ni des thèmes, mais des thèses : non pas des questions, parce que l’interrogation a déjà été posée dans la problématique (inutile de la multiplier dans l’annonce des parties) ; non pas des thèmes, parce qu’il s’agit pour toi de répondre à la problématique, et non pas d’en parler : un thème, c’est ce dont on parle, alors qu’une thèse, c’est ce que l’on affirme : dans chacune de tes parties, tu devras affirmer quelque chose, prendre une position et voir jusqu’où tu peux la tenir.
Tu peux t’autoriser de structurer ton annonce de plan avec des « dans un premier temps… dans un deuxième temps… », ou autres équivalents ; veille à bien varier les verbes : « nous verrons que… nous montrerons que… nous proposerons que… », etc.
Voilà, ton introduction est terminée, tu peux passer à la rédaction du développement !
Pour finir, la norme dépend des correcteurs, mais il peut être bon de construire ton introduction en trois paragraphes : un paragraphe pour l’accroche, l’énoncé du sujet et son analyse (c’est le paragraphe du sujet), un paragraphe pour la problématisation et la problématique (c’est le paragraphe du problème), et un paragraphe pour l’annonce du plan (c’est le paragraphe du développement à suivre).
Lire aussi : Comment bien réviser la philosophie à la maison ?
On répond à tes questions sur l’introduction en philosophie
À quoi sert l’introduction dans une dissertation de philosophie .
L’introduction dans une dissertation de philosophie au lycée a plusieurs fonctions essentielles. Tout d’abord, elle permet d’introduire le sujet et de le situer dans son contexte philosophique. Ensuite, l’introduction a pour objectif de présenter la problématique de la dissertation. La problématique doit susciter l’intérêt du lecteur et mettre en évidence les différentes approches possibles du sujet. Par ailleurs, l’introduction permet d’annoncer le plan de la dissertation. Il est important de structurer son développement en plusieurs parties, chacune répondant à un aspect spécifique de la problématique. En présentant brièvement les grandes lignes du plan, l’introduction donne une vision d’ensemble de la réflexion à venir.
Enfin, l’introduction doit donner envie de lire la suite de la dissertation. Elle doit être claire, concise et captivante, en utilisant des formulations précises et percutantes. L’introduction doit éveiller la curiosité du lecteur et lui donner l’impression que le sujet est intéressant et qu’il vaut la peine d’être approfondi.
Pourquoi soigner son introduction ?
Soigner son introduction dans une dissertation de philosophie pour une épreuve du bac au lycée revêt une importance particulière pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’introduction constitue le premier contact entre le correcteur et la copie. C’est grâce à cette partie que le correcteur va se faire une première impression de la qualité et de la pertinence de la réflexion développée. Une introduction soignée et bien construite permet ainsi de susciter l’intérêt et de capter l’attention du correcteur dès le départ.
Ensuite, l’introduction joue un rôle clé dans la clarté et la compréhension de la dissertation. En posant le sujet de manière précise, en définissant les termes clés et en exposant la problématique, elle permet au correcteur de comprendre immédiatement la direction que prendra le développement. Une introduction confuse ou mal formulée risque de semer le doute et de rendre la lecture de la dissertation plus ardue.
Par ailleurs, l’introduction contribue à la structuration et à la cohérence de la dissertation. En annonçant le plan, elle permet de donner une vision d’ensemble de la réflexion et de montrer que l’argumentation sera développée de manière ordonnée et logique. Une introduction bien organisée facilite la compréhension du raisonnement et donne une impression de rigueur et de clarté.
Quand rédiger l’introduction ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est généralement conseillé de rédiger son introduction à la toute fin de son devoir. Eh oui, une fois que tu as rédigé l’intégralité de ta dissertation, tu as les idées en place et il est souvent plus simple de rédiger son introduction. Tu sais de quoi tu vas parler et tu sais où tu vas aller.
Tu peux toujours rédiger ton introduction en premier lieu, mais cela te demandra un peu plus de maîtrise.
Quoi qu’il arrive, il est très important que tu gardes du temps pour rédiger une introduction dans ton devoir. Au début ou à la fin, peu importe tant qu’elle est là !
Quelle taille doit faire une introduction ?
L’introduction doit faire environ une page et demie (il est dangereux d’y accorder plus de temps et d’espace), et pense bien à dire « nous » et non « je », c’est une convention qui est attendue des correcteurs.
Un exemple d’introduction de dissertation en philosophie
Pour illustrer au mieux cet article, que penses-tu d’un petit exemple d’introduction ?
Nous avons rédigé un corrigé du sujet « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? » que tu peux retrouver juste ici . Tu y trouveras un exemple d’introduction de dissertation, mais également de développement et de conclusion. De quoi te permettre d’y voir un peu plus clair et de te préparer à l’épreuve de philosophie du baccalauréat.
Lire aussi : Bac 2022 : sujets de philosophie
Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !
Bac 2024 : les sujets de l’épreuve de spécialité SI
Bac 2024 : le corrigé de l’épreuve de spécialité ses, bac 2024 : les sujets de l’épreuve de spécialité ses, bac 2024 : le corrigé de l’épreuve de spécialité maths, bac 2024 : les sujets de l’épreuve de spécialité maths, bac 2024 : les sujets de l’épreuve de spécialité svt, bac 2024 : le corrigé de l’épreuve de spécialité svt, bac 2024 : les sujets de l’épreuve de spécialité arts, bac 2024 : les sujets de l’épreuve de spécialité physique-chimie, bac 2024 : le corrigé de l’épreuve de spécialité hggsp.

Inscris-toi à la newsletter du futur 👇🏼
Dans la même rubrique....

Bac 2024 : le corrigé de l’épreuve de philosophie
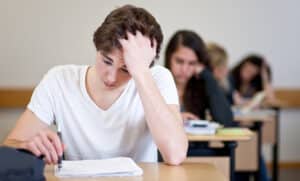
Bac 2024 : nos conseils pour réussir ta dissertation de philosophie

Quiz philosophie bac 2024 : teste tes connaissances en philosophie

5 conseils pour réussir son bac de philo
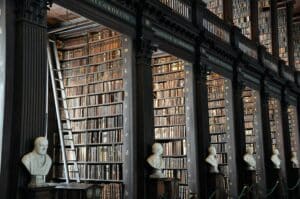
Les erreurs à ne pas commettre au bac de philosophie

Philosophie : l’idéal et le réel
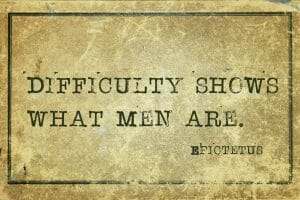
Philosophie : Ce qui dépend de nous chez Épictète
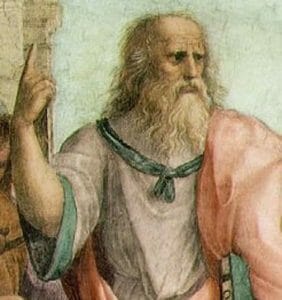
Philosophie : Repères sur Platon
Évitez les fautes dans vos écrits académiques
Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.
- Dissertation
Introduction de dissertation
Publié le 28 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.
Table des matières
Les parties d’une introduction de dissertation, 1. l’amorce de l’introduction d’une dissertation, 2. l’énoncé du sujet de l’introduction d’une dissertation, 3. la définition des termes et reformulation du sujet dans l’introduction d’une dissertation, 4. la problématique de l’introduction d’une dissertation, 5. l’annonce du plan dans l’introduction d’une dissertation, exemple complet d’introduction de dissertation, présentation gratuite.
L’introduction d’une dissertation permet de poser le sujet et d’exposer le problème auquel vous allez répondre dans le développement.
L’introduction d’une dissertation ne doit pas être trop longue (10 à 15 lignes) et est censée s’adresser à un lecteur qui ignore le sujet.
Elle doit comporter :
- une phrase d’accroche (amorce) ;
- l’énoncé du sujet ;
- la définition termes et reformulation du sujet ;
- une problématique ;
- l’annonce du plan.
Corriger des documents en 5 minutes
Trouvez rapidement et facilement les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation dans vos textes.
- Correction d'un document en 5 minutes
- Appliquer les modifications en 1 clic
- Corriger des documents pendant 30 jours
Essayez le correcteur IA

L’amorce ou entrée en matière se doit d’être originale et de susciter l’intérêt du lecteur. Vous pouvez utiliser un fait marquant, des statistiques, une citation ou un ouvrage.
Évitez absolument les amorces du type : « De tous le temps, les hommes se sont intéressés à… ».
Sujet : Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ?
« Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux », voici ce que promet la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen française établie en 1789, ainsi que la Constitution française de la Vème République de 1958.
Dans l’introduction de la dissertation, il faut bien évidemment introduire le sujet de la dissertation. S’il est constitué d’une citation, la citation doit figurer dans l’introduction avec le nom de l’auteur.
Ainsi, la « liberté » semble être une vertu naturelle et innée que l’être humain est en droit de posséder dès sa naissance. Etre « libre » signifierait « faire tout ce que l’on veut ». Toutefois, comme dans tout texte juridique, ce droit accordé à l’Homme n’est valable que si certains devoirs imposés sont respectés. La « liberté » est donc entourée de normes et de lois qui la définissent au sein d’une société démocratique.
Définir les termes du sujet permet d’expliciter le sens que l’on donne aux mots du sujet. Fournir des définitions précises vous permettra de définir un angle d’attaque particulier, car les mots peuvent avoir plusieurs définitions. Choisir une définition par terme du sujet vous permet d’éviter les malentendus.
On définit communément un être « libre » comme ayant le pouvoir de faire ce qu’il veut, d’agir ou non, et de n’être captif d’aucun devoir moral ou juridique. On peut donc lier la « liberté » à la seule « volonté » du sujet. Cette « volonté » pouvant être décrite comme le fait de « désirer » ou celui de « décider rationnellement » une chose. Toutefois, le « désir » peut sembler posséder un caractère coercitif qui rendrait toute liberté humaine impossible à atteindre.
Combien de fautes dans votre document ?
Nos correcteurs corrigent en moyenne 150 fautes pour 1 000 mots . Vous vous demandez ce qui sera corrigé exactement ? Déplacez le curseur de gauche à droite !

Faites corriger votre document
Poser le problème est une étape essentielle, car la problématique régit l’ensemble de la dissertation. Le développement de la dissertation doit permettre de répondre à la problématique énoncée en introduction. Il s’agit de formuler le problème initial.
Il est donc nécessaire de se demander si l’Homme est un être libre capable de faire des choix rationnels ou s’il est esclave de lui-même et de ses désirs ?
Annoncer le plan permet de donner au lecteur un aperçu de la structure du document. Le plan de votre développement est jugé dès l’introduction et le lecteur peut immédiatement détecter le hors-sujet. Faites donc attention à bien définir le plan de votre dissertation.
Pour répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire de s’interroger sur l’Homme en tant qu’individu considéré comme libre et doté de raison. Puis, il convient d’étudier l’Homme comme un être prisonnier qui subit la contrainte et l’obligation que lui impose sa personne ainsi que l’environnement qui l’entoure.
Voici un exemple complet d’introduction de dissertation avec les différentes parties que doit contenir une introduction.
Conseil… Faites relire et corriger votre dissertation avant de la rendre. Les fautes sont très pénalisées !
« Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux », voici ce que promet la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen française établie en 1789, ainsi que la Constitution française de la Vème République de 1958. Ainsi, la « liberté » semble être une vertu naturelle et innée que l’être humain est en droit de posséder dès sa naissance. Etre « libre » signifierait « faire tout ce que l’on veut ». Toutefois, comme dans tout texte juridique, ce droit accordé à l’Homme n’est valable que si certains devoirs imposés sont respectés. La « liberté » est donc entourée de normes et de lois qui la définissent au sein d’une société démocratique. On définit communément un être « libre » comme ayant le pouvoir de faire ce qu’il veut, d’agir ou non, et de n’être captif d’aucun devoir moral ou juridique. On peut donc lier la « liberté » à la seule « volonté » du sujet. Cette « volonté » pouvant être décrite comme le fait de « désirer » ou celui de « décider rationnellement » une chose. Toutefois, le « désir » peut sembler posséder un caractère coercitif qui rendrait toute liberté humaine impossible à atteindre. Il est donc nécessaire de se demander si l’Homme est un être libre capable de faire des choix rationnels ou s’il est esclave de lui-même et de ses désirs ? Pour répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire de s’interroger sur l’Homme en tant qu’individu considéré comme libre et doté de raison. Puis, il convient d’étudier l’Homme comme un être prisonnier qui subit la contrainte et l’obligation que lui impose sa personne ainsi que l’environnement qui l’entoure.
Voici une présentation que vous pouvez utiliser pour vos révisions ou lors de vos cours, afin d’expliquer la méthodologie de rédaction d’une introduction de dissertation.
Sur Google Slides En version PowerPoint
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.
Debret, J. (2020, 07 décembre). Introduction de dissertation. Scribbr. Consulté le 18 juin 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/introduction-dissertation/
Cet article est-il utile ?
Justine Debret
D'autres étudiants ont aussi consulté..., conclusion d’une dissertation : comment la rédiger , plan de dissertation.
Aide en philo
- Corrigé de dissert
- Dossiers / Cours
- Liste de sujets
- Votre correction
- BAC de philo
- Fonctionnement
- Nos certificats
- Infos presse
- MaPhilo recrute
Sujets de philosophie sur La morale
Liste des sujets corrigés les plus demandés :.
- International
- Figaro Live
- Les sujets corrigés complets du bac philo 2024 voies générale et technologique
Publié le 06/18/2024 à 9:30 AM , mis à jour le 06/18/2024 à 3:39 PM
Ce mardi 18 juin 2024, plus de 500.000 candidats planchent sur l' épreuve de philosophie du bac . L'épreuve dure quatre heures et se termine à midi. Les candidats pouvaient composer au choix sur deux sujets de dissertation et un commentaire de texte. Les candidats ont eu trois sujets au choix : un sujet de dissertation sur la science et la vérité, un deuxième sujet de dissertation sur l’État, et enfin un commentaire de texte à partir d’un texte de la philosophe Simone Weil (à ne pas confondre avec l’ancienne ministre Simone Veil). Ces sujets ont été corrigés par Aïda N'Diaye et Olivier Dhilly, professeurs de philosophie.
Les sujets du bac de philo 2024 pour la voie générale en bref :
Sujet de dissertation 1 : La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ?
Sujet de dissertation 2 : L'État nous doit-il quelque chose ?
Le commentaire de texte : Simone WEIL, La Condition ouvrière (1943)
Toute action humaine exige un mobile1 qui fournisse l'énergie nécessaire pour l'accomplir, et elle est bonne ou mauvaise selon que le mobile est élevé ou bas. Pour se plier à la passivité épuisante qu'exige l'usine, il faut chercher des mobiles en soi-même, car il n'y a pas de fouets, pas de chaînes ; des fouets, des chaînes rendraient peut-être la transformation plus facile. Les conditions même du travail empêchent que puissent intervenir d'autres mobiles que la crainte des réprimandes et du renvoi, le désir avide d'accumuler des sous, et, dans une certaine mesure, le goût des records de vitesse. Tout concourt pour rappeler ces mobiles à la pensée et les transformer en obsessions ; il n'est jamais fait appel à rien de plus élevé ; d'ailleurs ils doivent devenir obsédants pour être assez efficaces. En même temps que ces mobiles occupent l'âme, la pensée se rétracte sur un point du temps pour éviter la souffrance, et la conscience s'éteint autant que les nécessités du travail le permettent. Une force presque irrésistible, comparable à la pesanteur, empêche alors de sentir la présence d'autres êtres humains qui peinent eux aussi tout près ; il est presque impossible de ne pas devenir indifférent et brutal comme le système dans lequel on est pris ; et réciproquement la brutalité du système est reflétée et rendue sensible par les gestes, les regards, les paroles de ceux qu'on a autour de soi. Après une journée ainsi passée, un ouvrier n'a qu'une plainte, plainte qui ne parvient pas aux oreilles des hommes étrangers à cette condition et ne leur dirait rien si elle y parvenait ; il a trouvé le temps long.
Les pistes de correction pour le bac de philo voie générale
- Corrigé du commentaire du texte :
Nous savons depuis Marx ce que le travail ouvrier, à la chaîne, est susceptible de faire aux hommes et aux femmes qui l'exécutent. Une déshumanisation qui les transforme en marchandise de moindre valeur que les marchandises qu'ils produisent.
L'œuvre de Simone Weil s'inscrit en partie dans cette tradition et elle en renouvelle l'approche notamment dans son texte, La condition ouvrière , de 1942. Cette œuvre a ceci de très particulier que Simone Weil se fit elle-même ouvrière pour, au-delà de l'héritage de Marx, faire directement l'expérience du travail à l'usine.
Mais dans le fond, qu'est-ce qui rend le travail ouvrier si inhumain ? Que fait-il à l'âme et à la conscience des ouvriers ? Dans cet extrait, Simone Weil conclut sur une formule forte. L'ouvrier pourrait réduire à la fin de la journée sa « plainte » à l'égard des tâches qu'il vient d'effectuer à cette formule: « il a trouvé le temps long ». Que faut-il entendre par là et comment la question du travail, et plus précisément encore du travail à l'usine, s'articule-t-elle à celle du temps ?
Pour répondre à ces questions, Simone Weil commence par interroger les « mobiles » qui peuvent soutenir le travail de l'ouvrier, dans la mesure où toute action humaine doit répondre à une motivation (l.1 à 10). Dans un deuxième temps (l.10 à fin), elle montre comment l'existence de ces mobiles conduit à une brutalité qui se retourne contre l'ouvrier même puisqu'il ne se contente pas de la subir mais en devient également un acteur. C'est ce qui conduit Simone Weil à conclure sur sa thèse : la longueur ou lenteur du temps de l'ouvrier.
Dans un premier temps, donc Simone Weil inscrit le travail ouvrier dans le cadre général de toute tâche ou même toute action humaine : celle-ci exige un mobile. Nous ne pouvons agir – sous quelque forme que ce soit – si nous n'y trouvons pas notre compte, si nous n'y trouvons pas un besoin à satisfaire, un intérêt à remplir, un objectif à atteindre, etc… Aussi pénible soit-il donc, le travail ouvrier ne saurait déroger à cette règle et si, en dépit de cette pénibilité, certains acceptent de s'y soumettre, c'est bien justement qu'ils y trouvent leur compte d'une manière ou d'une autre, nous y reviendrons dans l'analyse des lignes suivantes où Simone Weil s'emploie à détailler les mobiles possibles du travail ouvrier.
Avant d'en venir à ce détail, l'autrice précise que cette question des mobiles de nos actions a une implication morale. Il ne s'agit pas seulement d'une rationalité neutre (le mobile permet d'expliquer nos actions), ni d'une source d'énergie (le mobile nous fournit « l'énergie nécessaire pour accomplir » l'action comme dit le texte) mais aussi de ce qui permet de juger de la valeur de nos actions, de déterminer si elles sont « bonnes ou mauvaises », selon que le mobile est lui-même « élevé ou bas ». Par exemple, si mon action a pour mobile une valeur morale désintéressée (l'altruisme), alors nous pourrons en conclure qu'elle est bonne. Au contraire, si le mobile est bas, par exemple un pur intérêt matériel et individuel (m'enrichir), alors, nous dirons que l'action est mauvaise. Reste à déterminer exactement ce que signifie « bas » ou « élevé », selon quel critère nous pouvons parler d'un mobile « bas » ou « élevé ». Est-ce bien un critère moral comme semble le suggérer l'utilisation des adjectifs « bonne ou mauvaise » pour qualifier l'action ? La suite du texte reprend ce vocabulaire : par exemple « il n'est jamais fait appel à rien de plus élevé » (l.9), « la pesanteur » (l.12). On peut en conclure, et nous y reviendrons qu'il s'agit aussi pour Simone Weil, au-delà d'enjeux moraux, d'opposer les mobiles et préoccupations strictement matériels à ce qui relève davantage de l'esprit, comme conscience, comme pensée, comme lieu de la spiritualité.
À partir de la ligne 2, le texte s'emploie donc à détailler ce que peuvent être les mobiles qui rendent possibles le travail ouvrier. Le début de la phrase le dit clairement, comme nous l'avons évoqué, le travail ouvrier est pénible. Cette pénibilité, paradoxalement, tient à la « passivité » que ce travail exige. Comme le soulignait déjà Marx, il y a dans le travail ouvrier un renversement par rapport au travail artisanal puisque l'ouvrier n'est plus maître de son ouvrage ni de son outil mais dominé par la machine au rythme de laquelle il doit se plier et qui, en quelque sorte, travaille, manipule et transforme la matière, à sa place. Et c'est précisément cette soumission à la machine qui rend le travail insupportable et le transforme en véritable torture, en le vidant de tout son sens. Simone Weil nous parle de la « condition ouvrière » du début du XXe siècle. On peut donc ajouter à cette pénibilité une pénibilité physique bien réelle : le bruit, la cadence imposée, les risques de blessures voire de mutilations, les positions et les gestes qui contraignent et blessent le corps, etc… L'épuisement que l'usine produit n'est pas seulement le fruit de la vacuité du travail effectué mais est aussi lié à une pénibilité physique bien réelle qu'ont montrée des ouvrages comme L'Etabli de Robert Linhart ou encore des films comme Ressources Humaines de Laurent Cantet.
Or, cette tâche, cette soumission que requiert le travail ouvrier se distingue de l'esclavage puisque l'ouvrier s'y plie de son plein gré : « pas fouets, pas de chaînes » ne sont nécessaires pour forcer l'ouvrier à effectuer ce travail. En cela, l'ouvrier n'est pas l'esclave : il entre libre dans le travail, il peut même bénéficier d'un contrat de travail qui formalise la relation qu'il entretient à son employeur. C'est bien simple : s'il n'est pas content des conditions qui lui sont faites, personne ne l'empêche de quitter son emploi et d'aller chercher du travail ailleurs. Mais ce qui peut sembler faire du travail ouvrier une meilleure situation que l'esclavage est en réalité pire puisque le texte nous dit qu'il serait peut-être plus facile de se soumettre à des « fouets, des chaînes ». Comment comprendre cet apparent paradoxe ? Comment imaginer préférable d'être violenté pour se soumettre à un travail plutôt que d'y aller de son plein gré ? La réponse se trouve sans doute dans la phrase précédente : en l'absence de contrainte extérieure, c'est « en soi-même » que l'ouvrier doit trouver les motivations pour se soumettre à cette tâche épuisante. Or nous voyons bien ici le problème : comment, sans en quelque sorte vendre son âme pour un salaire qui nous permet à peine de vivre, sans précisément s'en remettre aux mobiles les moins élevés et donc faire preuve de compromission avec notre propre dignité et nos propres valeurs, trouver la moindre raison de se plier à des tâches aussi aliénantes ? C'est précisément ce que va explorer la suite du texte.
La phrase suivante détaille en effet quels sont les mobiles auxquels l'ouvrier peut essayer d'adhérer pour supporter son travail. Simone Weil en propose trois : « la crainte des réprimandes et du renvoi, le désir avide d'accumuler des sous, et, dans une certaine mesure le goût des records de vitesse. » Les deux premières motivations apparaissent en effet comme les motivations principales du travail ouvrier et, plus généralement d'ailleurs, du travail comme activité nécessaire à la vie. Là encore, les analyses de Marx sont précieuses pour bien comprendre ce dont il s'agit puisque l'ouvrier est défini par Marx comme celui qui n'a rien d'autre à vendre que sa force de travail pour vivre (à la différence par exemple de l'agriculteur ou de l'artisan qui peut directement vendre les produits de son travail). Or il faut bien vivre. La liberté supposée dont dispose l'ouvrier par opposition à l'esclave et que le contrat de travail est supposé symboliser est donc bien fictive : d'où la crainte du renvoi qui est synonyme de misère, d'impossibilité de survie. La « peur des réprimandes » qu'évoque le texte peut sembler moins évidente. Comme l'avidité ou le goût de la performance qu'évoque Simone Weil, il faut y voir la manière dont le travail ouvrier contraint le travailleur jusque dans son âme en le faisant adhérer à des mobiles futiles (records de vitesse), indignes (avidité) ou qui lui font intégrer la logique hiérarchique et de contrôle que l'usine impose (« peur de la réprimande », on pense à la figure du contremaître qui veille à sans cesse rappeler les travailleurs à la cadence qu'ils doivent tenir, y compris par l'humiliation). C'est bien qu'il faille trouver en soi une raison de se soumettre à ce que l'usine exige comme le texte l'a déjà montré et que, comme nous l'avons vu également, on ne saurait trouver de motifs plus élevés que ceux-là.
C'est ce sur quoi conclut Simone Weil à la fin de cette partie, dans la phrase suivante : non seulement il n'est pas possible de faire « appel à rien de plus élevé » puisque rien dans ce travail mécanique et répétitif, rien dans les cadences imposées pour ce travail, ne mobilise l'esprit, la pensée ou l'âme et l'ouvrier est réduit à n'être qu'un simple rouage dans la gigantesque machine de la chaîne. Non seulement donc, on ne saurait trouver de mobiles plus élevés, mais de plus « tout concourt pour rappeler ces mobiles à la pensée et les transformer en obsessions. » Il n'est donc pas possible non plus de faire abstraction de ces basses motivations, de mobiliser son esprit pour autre chose (rêver par exemple) puisque la cadence imposée au corps contamine l'âme en exigeant une attention permanente. Impossible donc de ne pas finir par être « obsédé » par ces mobiles, pour satisfaire à l'exigence d'efficacité et pour trouver en soi, sur toute la journée de travail, l'énergie nécessaire pour mener à bien ces tâches et ces actions qui, selon la logique exposée au début du texte, se révèlent n'être que de basses actions, dévalorisant ainsi aux propres yeux du travailleur sa propre activité.
Dans un deuxième temps, Simone Weil en arrive aux conséquences que cela produit sur la pensée et l'âme de l'ouvrier. Alors même qu'il a son âme remplie de ces mobiles devenus obsédants, et que l'on pourrait donc imaginer une importante activité de l'esprit, c'est au contraire à une « rétractation » de la pensée que l'on assiste. Là encore cela soulève un paradoxe : l'esprit apparaît ici à la fois vide et plein. Nous avons vu en quoi il était plein de mobiles les plus bas. Voyons maintenant comment il se vide. Selon Simone Weil, il s'agit avant tout d'« éviter la souffrance ». La pensée, nous dit-elle « se rétracte sur un point du temps ». Que faut-il entendre par là ? On peut comprendre que le travail ouvrier exige, physiquement, matériellement d'abord, une attention permanente qui se fixe uniquement sur la tâche à effectuer afin d'éviter comme nous l'avons déjà évoqué les risques de blessure par exemple ou, tout simplement, tout ce qui pourrait ralentir la cadence. Sur la chaîne, il n'existe donc plus rien d'autre que le maintenant du geste et de la tâche présente, en train d'être effectuées. En cela, toute temporalité est réduite à un seul point, un seul instant. Cette rétractation de la pensée prend aussi une dimension spatiale en quelque sorte puisque la phrase suivante nous montre en quoi ce travail rend également insensible à la présence des autres. Chacun reste concentré, rétracté donc sur sa tâche propre, dans la totale ignorance des autres qui effectuent des tâches parfaitement similaires juste à côté. Le travail de ce point de vue là isole temporellement et spatialement. Nous retrouvons ici, comme nous l'avions évoqué, l'idée d'une « pesanteur » dans ce travail qui écrase l'âme et la conscience de l'ouvrier. C'est donc bien l'idée qu'il ne peut rien y avoir de « haut » ou d' « élevé » dans le travail ouvrier (tel qu'il est mis en forme à l'usine), dans les mobiles mais aussi dans la réalisation même de ce travail.
Cette dimension morale surgit d'ailleurs de nouveau dans la suite du texte puisque Simone Weil évoque alors la manière dont l'indifférence et la brutalité de ce système en quelque sorte contaminent le travailleur lui-même qui devient à son tour « indifférent et brutal comme le système dans lequel on est pris ». Comme nous venons de l'expliquer, les exigences des cadences imposées, l'épuisement qui écrase l'individu, la rétractation de la pensée que nous venons de décrire nous a permis de comprendre en quoi se produit dans ce cadre cet isolement de chacun à l'égard de chacun et le recours aux motivations les plus basses qui ne peuvent que produire cette indifférence morale ici évoquée. Se produit alors un jeu de miroir qui semble démultiplier à l'infini la violence de cette organisation : la brutalité du système se reflète en chacun (qui devient à son tour indifférent et brutal), chacun reflétant ensuite cette brutalité aux yeux des autres qui l'entourent, et ainsi suite à l'infini. La violence n'est pas ici symbolique puisqu'elle s'incarne bien concrètement dans les corps (« les gestes, les regards, les paroles ») qui constituent l'environnement dans lequel évoluent ces travailleurs. Dans A la ligne , Joseph Ponthus montrait ainsi comment, dans ce travail à la chaîne si particulier qu'est l'abattoir, la violence exercée à l'égard des animaux se répercutait chez les travailleurs eux-mêmes, illustrant ainsi à merveille ce que nous explique Simone Weil ici. Alors que nous pourrions nous attendre à ce que des conditions de travail aussi pénibles que celle que décrit le texte suscite entre les ouvriers une solidarité leur permettant de s'entraider et de bénéficier d'un rapport de force favorable face à ceux qui les emploient, c'est au contraire, semble nous dire Simone Weil, l'inverse qui se produit, chacun se retrouvant isolé face à un environnement où la violence semble partout.
Pour conclure cette description, Simone Weil, dans sa dernière phrase, fait surgir un nouvel élément : celui du temps. Car ce que nous venons de lire se résume ainsi, nous dit-elle, en une seule plainte « il (l'ouvrier) a trouvé le temps long ». Cette plainte nous dit-elle reste inaudible et incompréhensible à ceux qui ne partagent pas cette condition. C'est bien la raison qui la poussa à expérimenter elle-même directement la condition ouvrière, à se soumettre elle-même en se faisant ouvrière à cette situation tant seule l'expérience vécue, réelle peut ici permettre de comprendre ce dont il s'agit. Cette plainte, donc, porte sur le temps : il ne s'agit pas de pénibilité, de l'épuisement que nous avons déjà évoqué ou des cadences imposées, mais de la longueur ressentie du temps. Là encore, cette conclusion peut avoir de quoi surprendre car la rétractation de la pensée dans l'instant du geste répété que nous avons évoqué pourrait au contraire donner l'impression que le temps s'écoule plus rapidement : lorsque nous sommes absorbés par une tâche, ne dit-on pas en effet que nous ne voyons pas le temps passer ? Mais nous comprenons bien ici que si rend le temps si long dans ce travail, c'est, comme l'a montré le texte, l'absence totale d'élévation de l'âme : la pensée comme nous l'avons dit est à la fois pleine des mobiles les plus bas et vide de tout ce qui pourrait être source d'intérêt ou d'élévation. C'est donc, pourrait-on dire, un temps plein de vide que le travail ouvrier fait subir, comme un long ennui qui serait, en plus, pénible physiquement.
Par le détour de son argumentation sur ce que le travail fait à l'esprit plus encore qu'au corps, Simone Weil parvient donc à montrer en quoi le travail ouvrier n'est pas tant pénible parce qu'il nous épuise que parce qu'il fait à notre esprit qu'il écrase moralement en le remplissant des mobiles les plus bas tout en le vidant de la moindre possibilité d'élévation ou d'échappatoire.
- Corrigé du sujet de dissertation 1 : La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ?
Introduction :
Opposée à l'opinion, changeant, mouvante et instable car manquant de fondement rationnel, la science nous apparaît généralement comme ce qui permet d'avoir une connaissance véritable du monde et des choses. En effet, là où l'opinion se fonde sur l'apparence, ou sur le « on-dit », sur l'habitude, la science, qui se fonde sur la raison semble être ce qui se fait de mieux en matière de savoir dès lors que nous recherchons la vérité sur le monde et sur les choses. Mais constater que la science serait ce qui permet, contrairement à l'opinion, de parvenir à construire un discours vrai conduit-il nécessairement à penser qu'elle est en mesure de satisfaire notre besoin de vérité ? En effet, il semble assez évident de reconnaître que la science ne permet pas de connaître pleinement l'avenir, par exemple et force est de constater que bien souvent le besoin de vérité semble se satisfaire de discours infondés quand bien même seraient-ils faux. D'un côté, la science permet d'établir certaines vérités contre l'opinion et le danger de certaines croyances, mais d'un autre côté, elle n'est peut-être pas en mesure de répondre à toutes les questions que nous nous posons. Quelle place s'agit-il alors de donner à la vérité scientifique ? Faut-il considérer que notre soif de vérité doive être nécessairement satisfaite ?
I/ La science apparaît comme le meilleur moyen de satisfaire notre besoin de vérité
A/ La science n'est pas l'opinion
On peut ici penser aux analyses de Platon qui distingue science et opinion ou encore à celles de Bachelard, par exemple lorsqu'il montre en quoi l'opinion ne pense pas en « transformant des besoins en connaissance »
B/ La science justifie
La science a cette vertu de justifier ses discours.
Mais la science est-elle en mesure de tout connaître et de tout savoir ?
II/ La science n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions
A/ Distinguer le savoir et la croyance
Il est des questions auxquelles la science ne peut répondre. Tel est le sens de la distinction que Kant opère entre le savoir et la croyance. Pour qu'une vérité scientifique puisse être énoncée, certaines conditions doivent être réunies.
B/ La question « comment ? » et la question « Pourquoi ? »
La science est en mesure de répondre à la question « comment ? » mais non à la question « pourquoi ? ». Elle est en mesure de déterminer des rapports constants et nécessaires entre des phénomènes et tel est son champ.
C/ Les dangers à considérer que la science pourrait satisfaire ce besoin de vérité
Il peut y avoir un danger à penser que la science pourrait ainsi répondre à toutes les questions.
Au nom de la science et de sa prétention à satisfaire notre besoin de vérité, des idéologies mortifères ont pu se développer.
Faut-il alors renoncer à la science pour satisfaire notre besoin de vérité ? le danger n'est-il pas alors de redonner toute sa place à l'opinion ?
III/ Les limites du besoin de vérité
A/ La science renvoie à un discours sur le monde mais n'épuise pas toutes les questions
Constater que certains domaines échappent à la science ne revient pas à dire que dans tous les domaines tous les discours se valent.
B/ L'art face à la science
La vérité n'est pas l'exactitude, elle est un certain dévoilement de la réalité. En ce sens, l'art peut apparaître comme un moyen de satisfaire notre besoin de vérité, mais cette vérité n'est jamais considérée comme définitive.
C/ Quel besoin de vérité ?
Le besoin de vérité peut lui-même représenter un danger.
Conclusion :
La science ne peut satisfaire notre besoin de vérité, mais cela ne témoigne pas d'une faiblesse de celle-ci. C'est notre besoin de vérité qu'il s'agit d'interroger alors, en se demandant s'il ne s'agit pas simplement d'accepter l'idée selon laquelle tout ne relève pas de la nécessité.
- Corrigé du sujet de dissertation 2 : L'État nous doit-il quelque chose ?
L'État désigne un ensemble d'institutions qui permettent de réguler la société. Dès lors, il ne peut être efficace qu'à la condition de fixer un certain nombre de règles, et de devoirs : l'ordre n'est obtenu que si chacun respecte les règles et remplit les devoirs qui sont les siens. Dans la relation verticale que nous entretenons avec l'État, il semble que ce soit d'abord nous, citoyennes et citoyens, qui ayons des devoirs à son égard et qui lui devions donc quelque chose. Mais ces devoirs nous permettent de bénéficier en retour de droits. Or, dès lors, cela n'implique-t-il pas que, si nous avons des droits, l'État nous doive bien également quelque chose en retour des devoirs que nous acceptons ? Car si l'État ne nous doit rien, comment nos droits pourraient-ils être garantis et respectés ? Et même, comment l'État pourrait-il être légitime ?
Plan :
Partie 1. L'État doit nous garantir nos droits fondamentaux (liberté, sécurité)
L'Etat nous doit de nous assurer et garantir une protection en dehors de laquelle rien n'est possible pour nous, aucune existence ne peut réellement se développer.
L'Etat est donc constitué par le pacte social. Il ne désigne pas seulement des institutions qui nous gouvernent, mais aussi la communauté politique qui est fondée par le contrat social. Dans le Contrat Social , Rousseau prend l'image frappante du corps pour désigner ce que produit le contrat social.
Si, comme le dit Rousseau, l'Etat n'est qu'un ensemble d'institutions, son efficacité repose sur le pouvoir qu'il exerce. En tant qu'institution, il est doté d'une certaine force, qui lui permet de garantir notre sécurité en assurant l'ordre et la justice.
Partie 2. L'État ne nous doit rien, car ce qui prime ce sont les devoirs des citoyens à l'égard de l'État
Il faut ici distinguer le citoyen du sujet. Le sujet est simplement soumis à l'exercice d'un pouvoir. Le citoyen est membre d'un corps politique, dont il est effectivement le sujet dans le sens où il se doit d'obéir à un certain nombre de règles, mais au sein duquel il doit également être actif, c'est-à-dire participer aux actions de contrôle et d'élaboration du politique.
Ainsi, penser que l'Etat nous doit quelque chose serait, pour le citoyen, se retrouver dans la position du petit enfant face à ses parents, ou l'esclave ou l'animal face à son maître. Or, précisément, le modèle paternaliste de l'Etat ne paraît pas adéquat pour concevoir l'Etat de droit pour plusieurs raisons.
Partie 3. L'Etat ne nous doit rien car l'Etat ce n'est jamais que nous-mêmes
Revenons à Rousseau pour tenter de mieux définir l'Etat. La définition de l'Etat proposée par Rousseau va en effet plus loin. Le pacte social au fondement de l'Etat est un pacte d'association. Cela signifie que le peuple est l'instance souveraine, d'où le pouvoir politique tire sa légitimité et au-dessus de laquelle il n'y a personne. Pour Rousseau, un pouvoir politique qui n'a pas de légitimité démocratique n'est pas un Etat, mais un pur rapport de force.
Si l'Etat nous doit donc quelque chose car c'est la condition pour que nous nous nous soumettions à son pouvoir, ce n'est jamais qu'envers nous-mêmes et nos concitoyens que ces devoirs trouvent leur réel fondement. Et même, si nous poussons la logique de Rousseau plus loin encore, l'Etat ne nous doit rien à nous individuellement car nous ne sommes jamais que le membre d'un corps et c'est bien ce corps qui prime sur nos droits ou aspirations individuelles.
C'est la raison pour laquelle, nous ne pouvons penser que l'État nous doit quelque chose. Cela reviendrait à faire preuve d'une double naïveté. Naïveté quant à la nature profonde du politique qui est avant tout une communauté d'hommes qui contractent ensemble et à l'égard desquels l'État n'est qu'un rouage. Ce n'est pas l'État qui nous doit quelque chose, ce sont les autres. Naïveté également quant à la nature du pouvoir politique dont, en tant que réalité historique, particulière, nous ne pouvons avoir de garantie qu'il satisfasse ce que nous estimons nous être dus. L'État ne nous doit rien mais cela ne fait que rendre plus immenses encore nos devoirs et responsabilités politiques, qui nous engagent à l'égard de tous les autres avec lesquels nous vivons.
Le sujet du bac de philo à télécharger en PDF.
Les sujets du bac de philo pour la voie technologique en bref :
Sujet de dissertation 1 : La nature est-elle hostile à l'homme ?
Sujet de dissertation 2 : L'artiste est-il maître de son travail ?
Le commentaire de texte : PLATON, Les lois IX (IVème siècle av. J.-C.)
Il est nécessaire aux hommes de se donner des lois et de vivre conformément à ces lois, sous peine de ne différer en rien des bêtes les plus sauvages. Voici quelle en est la raison : aucun homme ne naît avec une aptitude naturelle à savoir ce qui est profitable pour la vie humaine en société et, même s'il le savait, à pouvoir toujours faire et souhaiter le meilleur. Car en premier lieu il est difficile de comprendre que l'art politique véritable doit prendre soin, non du bien particulier, mais du bien général – car le bien général rassemble, tandis que le bien particulier déchire les sociétés ; et le bien commun tout autant que le bien particulier gagnent même tous les deux à ce que le premier plutôt que le second soit assuré de façon convenable. En second lieu, même si l'on était assez habile pour se rendre compte que telle est la nature des choses, et qu'on ait à gouverner un État avec un pouvoir absolu et sans rendre aucun compte, on ne pourrait pas rester fidèle à ce principe et faire passer pendant toute sa vie le bien commun de la société au premier rang et le bien particulier au deuxième. En fait la nature mortelle de l'homme le portera toujours à vouloir plus que les autres et à s'occuper de son bien particulier, parce qu'elle fuit la douleur et poursuit le plaisir sans tenir compte de la raison, qu'elle les fera passer l'une et l'autre avant le plus juste et le meilleur, et, s'aveuglant elle-même, elle finira par se remplir, elle et toute la société, de toutes sortes de maux.
- Corrigé du commentaire de texte
I/ Éléments d'analyse
A/ Expliquez pourquoi vivre sans lois serait vivre comme «les bêtes les plus sauvages»
Les lois sont ce qui permet de réguler la vie en communauté, elles déterminent ce qui est permis et ce qui est interdit. En tant que telles, elles s'imposent à toutes et à tous dans les limites qu'elles posent. En dehors de toute loi, ne règnent que des rapports de force et de domination. Dès lors, rien ne nous distingue des bêtes sauvages. C'est d'ailleurs ainsi que Kant définira la sauvagerie, à savoir l'indépendance à l'égard de toute loi. L'homme se caractérise alors par sa capacité à dépasser sa propre animalité et c'est dans ce dépassement qui consiste à ne pas entretenir que des rapports de force
B/ Expliquez pourquoi « l'art politique véritable doit prendre soin (…) du bien général »
Chaque individu est animé par un intérêt particulier et chaque individu a tendance à rechercher son propre bien, son bien particulier. Toutefois, la poursuite des intérêts particuliers multiples et divergents est immédiatement source de conflits et installe les individus dans des rapports de force. La politique a pour but, en premier lieu, de permettre aux individus de vivre en commun. Dès lors, elle s'attache à prendre en compte, non pas d'abord les intérêts particuliers mais l'intérêt général et donc ce qui constitue le bien commun. La détermination du bien général est ce qui permet de ne pas diviser les individus.
C/ Quel sens peut-on donner à l'expression « le plus juste et le meilleur » ?
En vertu de sa nature propre, tout homme recherche son bien propre et ceci parce que, comme être sensible, il ressent de la douleur et du plaisir, parce qu'il se compare sans cesse aux autres avec lesquels il entre sans cesse en compétition. Ce n'est pas une affaire de justice, mais une affaire d'intérêts propres. Le plus juste serait de poursuivre ce qui est pour le bien de tous, et c'est en ce sens que ce serait le meilleur, ne serait-ce que parce qu'en ne poursuivant que son bien propre, on met en péril l'unité de la société. Comme le souligne le texte, la recherche unique du bien particulier déchire les sociétés.
II/ Éléments de synthèse
A/ Quelle est la question à laquelle l'auteur répond dans ce texte ?
Dans ce texte il s'agit de se demander pourquoi il est nécessaire de se donner des lois pour vivre en commun.
B/ Dégagez les différents moments de l'argumentation
Dans un premier temps, Platon énonce la thèse du texte : Il faut se donner des lois parce que la tendance naturelle des hommes ne consiste pas à vivre selon ce qui est bon pour la vie en société
Puis, dans un deuxième temps, il en donne les raisons qui sont au nombre de deux :
- Il est difficile de comprendre la nécessité de dépasser la recherche du bien particulier au profit du bien commun
- Même lorsqu'on l'a compris, il est difficile de le mettre en pratique
Dans un troisième temps, il montre en quoi cela tient à la nature mortelle de l'homme
C/ En vous appuyant sur les éléments précédents, dégagez l'idée principale du texte
L'idée principale du texte consiste à affirmer que la nature humaine, et en particulier sa nature mortelle, conduit majoritairement les hommes à poursuivre leurs intérêts particuliers, soit par ignorance de ce qui est nécessaire à la vie en société, soit par une sorte de faiblesse face à la difficulté qu'il y a à se contraindre à vivre selon le bien commun. Dans ce texte, Platon s'attache donc à affirmer la nécessité qu'il y a à établir des lois et montre sur quels principes elles doivent être établies. Autrement dit, ce n'est pas spontanément que les hommes se donnent les moyens de vivre en société.
III. Commentaire
A/ D'après le texte, quels sont les maux qui peuvent menacer la société ?
Les maux qui menacent la société sont avant tout la recherche du plaisir individuel, et surtout la tendance que les hommes ont à se comparer sans cesse aux autres et à vouloir plus qu'eux. C'est dans l'opposition entre le bien particulier et le bien général que réside toute la tension. Le pire des maux qui puisse menacer la société est donc la sauvagerie, à savoir le désordre sans limites et la mise en péril de la vie des individus. Si nous étions des dieux, des êtres immortels, alors sans doute n'aurions-nous pas besoin de lois, mais tel n'est pas le cas : nous sommes des êtres mortels, des êtres finis et cette finitude nous installe dans des logiques de comparaison dès lors que nous nous confrontons aux autres. Ce qui menace la société, dont nous avons besoin pour vivre est donc nous-mêmes, notre nature qui risque de conduire la société à se disloquer.
B/ En vous appuyant sur votre compréhension du texte, vous vous demanderez s'il est possible, et de quelle manière, de concilier le bien des individus et celui de la communauté.
Considérer qu'il est nécessaire, pour qu'une vie en commun soit possible, de dépasser la recherche des biens individuels semble une évidence dès lors que l'on s'efforce de penser une vie en commun. En effet, une vie collective dans laquelle chacun serait uniquement à la recherche de son bien propre, semble impossible. La vie en société exige de faire l'effort de dépasser la recherche de ses intérêts particuliers. Pour que nous puissions vivre en commun, il faut des biens communs. Mais faire un tel constat ne suffit pas. En effet, il se pourrait bien que le bien des individus puisse rentrer en contradiction avec le bien de la communauté. La recherche du bien de la communauté consiste-t-elle à nier le bien des individus ou est-il possible de concilier les deux ?
Il y a une tension évidente entre le bien des individus et celui de la communauté. Il s'agissait alors de donner ici des exemples : un individu peut chercher, pour son bien propre à s'enrichir, par exemple, mais la vie en communauté exige qu'il y ait des biens communs, par exemple des routes, des hôpitaux, une justice etc…Pour que ces biens communs existent, il faut alors que chaque individu dépasse son intérêt particulier et participe à l'obtention de ces biens communs. Une telle démarche peut être vécue comme une atteinte à la liberté ou encore comme une atteinte à la propriété. Dans un premier temps, on pourrait montrer comment en quoi, la détermination du bien de la communauté suppose la négation du bien des individus, comment l'individu doit s'oublier dans la communauté.
Il s'agirait alors de se demander si une conciliation n'est pas possible, si la détermination du bien commun suppose nécessairement la négation de tout bien individuel. Notons simplement ici que la justice, qui peut apparaître comme un bien commun, n'est pas étrangère à tout bien individuel. En effet, dans une société où ne règnent que les rapports de force, où chacun ne serait mû que par son intérêt propre, aucun individu ne serait en sécurité. On pouvait penser ici aux analyses de Hobbes, par exemple, lorsqu'il aborde l'état de nature comme un état de guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun. Dans un tel état, même celui qui serait le plus fort risquerait sans cesse sa vie. On pourrait alors se demander si l'opposition première entre le bien des individus et le bien de la communauté est si radicale. En effet, ne peut-il pas être dans l'intérêt de l'individu qu'il y ait un bien commun ? Mon intérêt bien compris ne consiste-t-il pas à déterminer un intérêt commun ?
- Corrigé du sujet 1 : La nature est-elle hostile à l'homme ?
Quelle étrange question ! Outre la personnification de la nature à laquelle on attribuerait un sentiment d'inimitié à l'égard des hommes, cette formulation semble également inverser le rapport de force ou de nuisance que nous pouvons aujourd'hui constater entre l'homme et la nature ? N'est-ce pas en effet plutôt l'homme qui paraît hostile à la nature tant il semble ne pas la respecter, la détruire, la dominer ?
Lorsque nous pensons à la nature, deux imaginaires sont convoqués. D'abord, la beauté et l'harmonie avec soi et le monde, nécessaires au bien-être. A contrario, ce qui est trop artificiel ou dénaturé serait source de souffrance et de désordre. Régler nos vies sur la nature, ne serait-ce pas dès lors la meilleure garantie de bonheur et de justice et dans ce sens-là, la nature n'est-elle pas, loin d'être hostile à l'homme, au contraire ce qu'il y a de meilleur pour lui ?
Mais la nature évoque aussi la violence. « L'homme est un loup pour l'homme », et si les individus se retrouvaient régis par leur seule nature, le chaos et la loi de la jungle régneraient. C'est ce qu'ont montré les nombreuses images de pillage qui ont circulé après l'ouragan Katrina en 2005, par exemple. L'hostilité peut en effet se définir comme une volonté de nuire, comme une malveillance à l'égard d'un ennemi auquel on voudrait du mal. En ce sens, la nature n'est-elle pas précisément un environnement hostile pour l'homme ? Si l'humanité s'est tant employée à modifier et dominer la nature, n'est-ce pas précisément parce que celle-ci apparaît d'abord comme un milieu au sein duquel la survie n'est précisément pas assurée s'il n'y apporte pas les modifications nécessaires pour réduire les dangers qu'il y court ? De ce point de vue là, nous pourrions donc supposer qu'il y a, en effet, bien une forme d'hostilité de la nature à l'égard de l'homme : elle n'est, tout simplement, pas faite pour lui ! Mais, comme nous l'avons déjà évoqué, que penser d'une telle personnification ? Quel sens peut-il y avoir à prêter ainsi une intention à la nature ? Plus fondamentalement encore, n'est-ce pas dans la nature de l'homme de s'adapter à son environnement, quel qu'il soit ?
Partie 1. La nature n'est pas hostile à l'homme car elle est son environnement premier
On ne peut donc accuser la nature d'hostilité à l'égard de l'homme, puisqu'au contraire il n'y a pas de valeur morale en son sein (ce que nous explique Spinoza dans L’Ethique)
Nos valeurs morales ne sont donc ni absolues, ni désintéressées, ni coupées de la nature. Au contraire, ce ne sont que des variations de l'instinct de conservation en nous : nous appelons bien ce qui est utile à notre conservation (collective ou individuelle) et mal ce qui nous est nuisible.
C'est donc une conception totalement erronée et de l'homme et de la nature qui pourrait nous conduire à voir dans la nature un environnement hostile à l'homme. Au contraire, celle-ci est neutre, en nous, comme à l'extérieur de nous.
Partie 2. La nature est hostile à l’homme car elle menace sa survie
La nature n'est pas faite pour l'homme car, livré à lui-même, dans un pur état de nature où il ne pourrait recourir ni à l'aide d'autrui ni au moindre outil, ni à la protection d'un Etat, l'homme serait tout simplement incapable de survivre.
Cette hostilité n'est pas seulement dans les conditions de survie à l'extérieur de nous : nous la portons également en nous. La nature ne désigne en effet pas seulement l'environnement donné dans lequel nous évoluons mais également la nature en nous, ce qui est donné en nous, comme nature humaine, ou pas d'ailleurs.
Partie 3. La nature n'est pas hostile à l'homme car notre relation à la nature ne s'inscrit pas dans un rapport de force
Cette complexité est présente dans toute l'œuvre de Rousseau. Dans le Second Discours, la nature constitue, en effet, un idéal d'harmonie et de pureté des hommes . Mais, comme le rappelle le philosophe, l'état de nature, parce qu'il finit par être conflictuel, est un état dont les hommes veulent sortir.
Nous sommes à la fois en elle et en dehors d'elle, la conditionnant et conditionnés par elle, et cette complexité ne nous permet pas de penser notre relation à la nature sous le rapport, simpliste et réducteur, de l'hostilité.
La nature n'est pas hostile à l'homme. Certes, elle constitue un environnement qu'il nous est difficile de dominer et où la stricte survie immédiate peut paraître impossible. Mais notre rapport à la nature est plus complexe et nous ne saurions, sur la base de cette prétendue hostilité de la nature, justifier notre propre hostilité à son égard. Nous sommes dans la nature autant qu'en dehors d'elle, dépendant d'elle autant que nous la dominons et dans ce sens notre relation à la nature n'a pas à être un rapport de force. Toute hostilité en est alors exclue.
- Corrigé du sujet 2. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ?
Introduction
1/La science apparaît comme le meilleur moyen de satisfaire notre besoin de vérité
2. La science n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions
3. Les limites du besoin de vérité
Le sujet du bac de philo techno 2024 à télécharger en PDF.
Envie de continuer à réviser ?
Inscris-toi et accède gratuitement à toutes nos fiches, quiz, annales du bac !
La rédaction vous conseille
- Quiz bac philo : si vous savez à qui appartiennent ces citations, vous êtes au point en philosophie
- Pour le bac de philo, des quiz, des fiches, des annales et nos conseils pour réussir l’épreuve
Dissertation sur Manon Lescaut !
Annonce importante :, mon stage express pour obtenir 20/20 à l'oral de français ferme dans 1 jour 10 heures 18 minutes 49 secondes.
Clique ici pour t'inscrire !

Voici un exemple de dissertation sur Manon Lescaut de l’Abbé Prévost. (Parcours au bac de français : personnages en marge, plaisir du romanesque ).
Important : Pour faciliter ta lecture, le plan de cette dissertation est apparent et le développement est présenté sous forme de liste à puces. N’oublie pas que le jour J, ton plan et ton développement doivent être intégralement rédigés.
D’après vous, est-ce l’immoralité du personnage de Manon Lescaut qui fait le plaisir de la lecture du roman ?
Pour que ce corrigé te soit utile, entraîne-toi auparavant à réaliser ce sujet avec ma fiche et mes vidéos sur Manon lescaut !
Introduction
L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut de l’Abbé Prévost, occupe le septième et dernier tome des Mémoires d’un homme de qualité publiées entre 1728 et 1731. Ce récit enchâssé dans l’histoire du marquis de Renoncour narre l’aventure amoureuse et tumultueuse du chevalier des Grieux et Manon Lescaut.
Le plaisir de la lecture de ce roman repose-t-il sur l’immoralité du personnage éponyme de Manon Lescaut ?
Dans une certaine mesure, le lecteur peut trouver dans l’immoralité de l’héroïne une source de plaisir . L’immoralité de Manon Lescaut relève aussi d’une soif de liberté qui peut ravir le lecteur . Mais lier le plaisir de la lecture uniquement à l’immoralité de Manon Lescaut est réducteur : ce plaisir repose également sur d’autres ressorts.
I – L’immoralité de Manon Lescaut : une source de plaisir pour le lecteur
A – manon lescaut transgresse la morale et la religion, ce qui suscite la curiosité et le plaisir du lecteur.
- C’est une femme entretenue par des hommes
- Elle n’hésite pas à transgresser les règles sociales : travestissement en homme lorsqu’elle veut s’enfuir sans être vue de la Salpêtrière par exemple.
- Son goût immodéré pour le luxe et les plaisirs conduisent Manon Lescaut à placer l’argent au-dessus de tout autre valeur : « Manon était passionnée par le plaisir; je l’étais par elle » dit le chevalier Des Grieux.
- On peut faire un parallèle avec La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils (1848), qui a puisé son inspiration dans le roman de l’abbé Prévost. Marguerite Gauthier, courtisane, qui se fait entretenir par plusieurs hommes, va vivre une histoire d’amour avec un jeune bourgeois Armand Duval.
B – La conduite immorale de Manon Lescaut est source de rebondissements
- Manon Lescaut joue avec la faiblesse des hommes : son inconstance , ses infidélités multiples sont autant de rebondissements qui maintiennent le lecteur en haleine.
- Le frère de Manon fait preuve d’une conduite peu recommandable : il pousse le couple au vice. C’est un personnage qui nous entraîne vers un univers social marginal.
- Le vol et l’escroquerie : Manon Lescaut et Des Grieux commettent vol et escroquerie auprès d’hommes libidineux au point où ils sont placés en détention, s’enfuient et sont recherchés par la police.
II – Mais Manon Lescaut ne peut être réduite à un personnage immoral
A – des grieux : un personnage subversif et plaisant.
L’immoralité du Chevalier est aussi patente. Il transgresse la morale :
- par son choix du libertinage
- par sa vie en marge de la religion
- par ses actions : Des Grieux a commis des crimes graves en tirant sur le gardien de la prison de Saint-Lazare, en faisant séquestrer le jeune GM… Il fait le choix de l’amour, quel qu’en soit le prix , contrairement à son ami Tiberge qui incarne la raison et le sauve à de multiples reprises.
B – L’immoralité de Manon Lescaut, signe de sa liberté
- Manon Lescaut peut être considérée comme une femme libre qui s’affranchit des codes sociaux, religieux et moraux : elle choisit de séduire des hommes plus âgés et riches pour sauver son couple avec le Chevalier
- Le plaisir du lecteur provient de ce dilemme entre immoralité et liberté
- Un parallèle peut être établi avec Carmen de Prosper Mérimée : Manon et Carmen sont deux femmes similaires par leur quête de l’indépendance et de la liberté. Mais les deux fins diffèrent : Don José tue Carmen, alors que le Chevalier Des Grieux erre aux côtés de Manon dans le désert américain avant qu’elle ne meure d’épuisement.
III – Le plaisir de la lecture repose également sur d’autres ressorts
A – la construction et le rythme du roman.
- Le récit enchâssé : le narrateur Renoncour rencontre Des Grieux qui lui fait le récit de ses aventures. Cette construction complexe est source de plaisir et déploie une esthétique baroque .
- La dimension picaresque : autobiographie fictive, multiples péripéties et voyage initiatique (flagrant délit de vol et d’escroquerie, emprisonnement, meurtre d’un garde, déportation en Louisiane, duel avec le fils du Gouverneur…) multiplie le plaisir du lecteur.
- Points communs avec l’héroïne du roman de Moll Flanders de Daniel Defoe : fuite de la misère, déportation en Amérique, vols. C’est une dimension picaresque qui plaît au 18ème siècle.
B – L’instruction des mœurs
- L’auteur affiche une double ambition dès l’Avis de l’auteur , au début du roman : plaire et instruire . Selon lui, dépeindre l’immoralité permet de mieux la prévenir : « L’ouvrage entier est un traité de morale, réduit agréablement en exercice. «
- Manon Lescaut est ainsi présenté comme un contre-exemple de la vertu .
- La fin est donc tragique (mort de Manon Lescaut) mais pédagogue : elle signifie que la passion amoureuse, sans respect de la morale et de la religion, est fatale .
En définitive, les condamnations du roman témoignent d’un contexte de réception complexe.
Le tiraillement entre le respect des normes morales, sociales et religieuses et la passion amoureuse est au cœur du roman de l’abbé Prévost et explique la fascination de ce roman sur le lecteur.
Le personnage de Manon Lescaut incarne ce tiraillement par sa nature et sa conduite en marge de la société. Mais son attitude signe également sa liberté de femme pour échapper à la misère sociale. En cela, elle apparaît comme un personnage complexe, mémorable, qui suscite le plaisir du lecteur.
Mais ce n’est pas seulement son immoralité qui procure le plaisir de la lecture. D’autres ressorts romanesques sont tout aussi puissants : la dimension picaresque du récit ou encore l’instruction des mœurs. Manon Lescaut partage l’art de la manipulation des hommes avec Mme de T… dans Point de Lendemain de Vincent Denon (1777).
Pour aller plus loin sur Manon Lescaut :
- Manon Lescaut, la rencontre amoureuse
- Manon Lescaut : le souper interrompu après la première trahison de Manon
- Manon Lescaut, les retrouvailles à Saint-Sulpice
- Manon Lescaut : la lettre de Manon
- Manon lescaut, le dîner de dupe avec G…M…
- Manon Lescaut : l’évasion de Saint-Lazare
- Manon Lescaut, la rupture entre père et fils
- La mort de Manon Lescaut
- Manon Lescaut, excipit
Autres dissertations rédigées :
- Dissertation sur La Peau de chagrin
- Dissertation sur Sido et Les Vrilles de la vigne
- Dissertation sur Juste la fin du monde
- Dissertation sur Le Malade imaginaire
- Dissertation sur Les Fausses confidences
- Dissertation sur Gargantua
- Dissertation sur Les Caractères
- Dissertation sur La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
- Dissertation sur Cahiers de Douai
- Dissertation sur Mes forêts d’Hélène Dorion
- Dissertation sur La Rage de l’expression

Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.
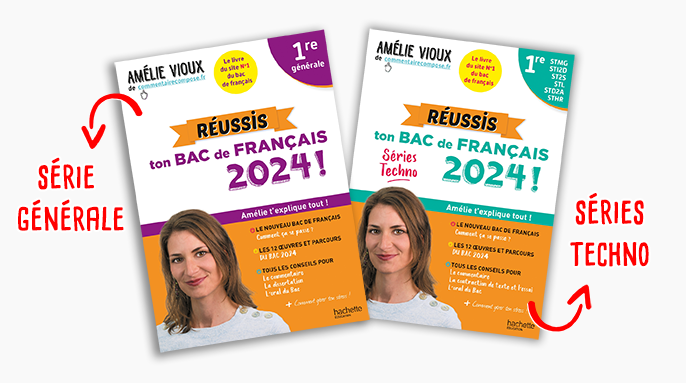
Qui suis-je ?
Amélie Vioux
Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).
Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.
Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.
Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.
J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.
Laisse un commentaire ! X
Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.
Site internet

- Fiches d’introduction au droit
- Fiches de droit constitutionnel
- Fiches d’introduction historique au droit
- Fiches de droit des personnes
- Fiches de droit de la famille
- Fiches de droit des contrats
- Fiches de droit administratif
- Fiches de droit pénal
- Fiches de responsabilité civile
- Fiches de droit de l’Union européenne
- Fiches de régime général des obligations
- Fiches de procédure civile
- Fiches de droit des biens
- Fiches de droit commercial
- Fiches de droit commun des sociétés
- Fiches de droit des contrats spéciaux
- Fiches de droit international public
- Méthodologie
- Introduction au droit
- Droit constitutionnel
- Introduction historique au droit
- Droit des personnes
- Droit de la famille
- Droit des contrats
- Droit administratif
- Droit pénal
- Responsabilité civile
- Droit de l’Union européenne
- Régime général des obligations
- Procédure civile
- Droit des biens
- Droit commercial
- Droit des sociétés
- Contrats spéciaux
- Droit international public
Le droit et la morale
Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement l’introduction au droit]
Si vous lisez ces lignes, vous êtes probablement étudiant en première année de droit.
Peut-être même que vous avez une dissertation à faire sur le thème du droit et de la morale.
Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons voir en détails la distinction entre le droit et la morale, ainsi que les points de rapprochement entre ces deux notions.
Sans plus attendre, c'est parti !
Définitions du droit et de la morale
Avant toute chose, il convient de définir le droit et la morale.
Définition du droit
La notion de droit est susceptible de deux définitions différentes. On parle de droit objectif (au singulier) et de droits subjectifs (au pluriel).
Le droit objectif désigne l’ensemble des règles de droit, c’est-à-dire les règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Il correspond à ce que l’on désigne communément lorsque l’on cite « le » droit.
Quant aux droits subjectifs, ce sont les prérogatives individuelles reconnues aux personnes. Par exemple, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété sont des droits subjectifs.
A noter : Si vous voulez en savoir plus sur la distinction entre droit objectif et droits subjectifs, vous pouvez cliquer ici .
Lorsque l'on s'intéresse au thème du droit et de la morale, la notion de droit renvoie au droit objectif.
On peut donc définir le droit comme "l'ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société" (G. Cornu, Vocabulaire Juridique).
Définition de la morale
La morale, quant à elle, désigne "l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie" , selon la définition du dictionnaire Larousse.
Ainsi, autant le droit que la morale correspondent à des règles de conduite. Mais si ces deux notions se recoupent en partie, elles doivent cependant être distinguées. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cet article.
La distinction entre le droit et la morale
Les critères de distinction entre le droit et la morale, premier critère : la source de la règle.
Le droit et la morale ont des sources différentes.
La règle morale vient de la conscience de l'individu. Sa source est interne à l'individu.
A l'inverse, la règle de droit est édictée par les autorités publiques (la loi est créée par le Parlement, les règlements le sont par le gouvernement, etc.). La source du droit est externe à l'individu.
Deuxième critère : la finalité de la règle
Le droit et la morale se distinguent par leurs finalités respectives.
La morale vise le perfectionnement intérieur de l'homme. Elle est destinée à améliorer l'individu. Sa finalité est donc individuelle.
Le droit a pour but la paix dans la société, le maintien de l'ordre social. Sa finalité est donc sociale, et non individuelle.
Troisième critère : la sanction de la règle
La règle de droit et la règle morale font l’objet de sanctions différentes.
En cas de violation d’une règle morale, la personne éprouvera des remords, des regrets, c’est-à-dire les reproches de sa propre conscience. Il s’agit de sanctions internes à l'individu.
En revanche, la violation d'une règle de droit entraîne une sanction étatique, c'est-à-dire une sanction déterminée et infligée par l’autorité publique. Cette sanction est également garantie, in fine , par la force publique : l’Etat peut recourir à la contrainte pour infliger la sanction à la personne qui a violé la règle de droit.
L'indifférence du droit à l'égard de la morale
La distinction qui existe entre le droit et la morale se confirme par l'indifférence du droit à l'égard de la morale dans un certain nombre de domaines.
Par exemple, le droit des contrats est en principe indifférent au déséquilibre entre les obligations du contrat. En effet, l' article 1168 du Code civil dispose que « le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement » . Cela signifie par exemple qu'une personne qui achète un tableau au prix de 10 000 €, alors que sa valeur était en réalité de 5000 €, ne peut pas demander la nullité du contrat . Pourtant, les prestations sont déséquilibrées, et une telle transaction peut à ce titre sembler immorale. Mais le droit des contrats est indifférent au déséquilibre contractuel.
Dans d'autres domaines, le droit est indifférent à la morale car les problèmes à résoudre sont uniquement techniques. C'est par exemple le cas pour :
- les règles du Code de la route
- les règles comptables
- le droit constitutionnel
- la plupart des règles fiscales, dont le seul but est de récupérer de l'argent pour alimenter le budget des collectivités publiques
Par ailleurs, l'application d'une règle de droit peut donner lieu à une situation immorale. La prescription en est une bonne illustration.
D'abord, le droit considère que lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis la commission d’une infraction sans que l’action publique n’ait été exercée, cette dernière s'éteint, empêchant dès lors toute poursuite. C'est ce qu'on appelle la prescription de l'action publique. Cette prescription fait donc perdre son caractère juridiquement répréhensible à un acte qui moralement reste toujours condamnable.
Ensuite, le droit considère que le simple écoulement du temps peut permettre l’acquisition ou l'extinction d’un droit. On parle de prescription acquisitive dans le premier cas et de prescription extinctive dans le second cas. Or aussi bien la prescription acquisitive que la prescription extinctive peuvent donner lieu à des situations immorales. La prescription acquisitive permet à l’occupant d’un bien immobilier, par simple possession pendant un certain délai, d'en devenir le propriétaire, alors même que ce bien ne lui appartenait pas. De même, la prescription extinctive peut, par exemple, faire disparaître le droit pour le créancier d’exiger le paiement auprès de son débiteur, simplement parce qu'un certain délai s'est écoulé.
L'influence de la morale sur le droit
L’opposition entre le droit et la morale n’empêche pas la morale d’exercer une grande influence sur le droit.
La consécration de règles morales dans le droit
De nombreuses règles morales ont été consacrées dans le droit et s'expriment sous la forme d'obligations juridiques. La règle de droit n'est alors que la traduction de commandements moraux.
On peut citer comme exemples :
- l'interdiction de tuer (l' article 221-1 du Code pénal réprime le meurtre)
- l'interdiction de voler (l' article 311-3 du Code pénal sanctionne le vol)
- l'interdiction de la polygamie (on la retrouve à l' article 147 du Code civil et l' article 433-20 du Code pénal )
- l'obligation conjugale de respect, fidélité, secours et assistance (reprise à l’ article 212 du Code civil )
En outre, le droit accepte parfois qu’une obligation purement morale devienne une obligation juridique. Par exemple, l'obligation alimentaire entre collatéraux est une obligation purement morale ; à la différence de l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants, elle n'est pas consacrée par le Code civil. A ce titre, le droit n’impose pas au frère de prendre en charge sa sœur si elle est dans le besoin. Mais si le frère le fait volontairement, il ne pourra réclamer ensuite le remboursement des sommes dépensées. En effet, l'exécution volontaire d'une obligation naturelle ne peut être remise en cause par la suite. L' article 1302 du Code civil dispose que "la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées" . Ainsi, le droit qui n’imposait pas au frère de nourrir sa sœur lui interdit en revanche de changer d’avis une fois qu’il s’est exécuté. L'obligation morale de nourrir ses frères et sœurs est donc reconnue par le droit, qui peut la transformer en obligation juridique lorsque le débiteur l'a volontairement exécuté.
La prise en compte de la morale dans le droit
Outre la consécration de règles morales dans le droit, il faut également évoquer la prise en compte de la morale par le droit, qui se manifeste à différents égards.
D'abord, on peut retrouver dans le droit des notions proches de la notion de morale. Ainsi, l' article 6 du Code civil dispose que : "on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs" . En imposant la conformité des contrats aux « bonnes mœurs », cet article 6 empêche de porter atteinte aux règles morales les plus élémentaires. De même, l' article 1104 du Code civil affirme que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi" . Or la bonne foi en droit des contrats impose au contractant d’adopter un comportement loyal et coopératif, et de ne pas nuire à son cocontractant. Il s'agit donc d'une notion morale, qui permet de moraliser la formation et l'exécution des contrats. Par ailleurs, la notion de bonne foi joue un rôle important dans d'autres branches du droit, comme par exemple le droit des biens et le droit des affaires.
En outre, certains principes juridiques témoignent de la pénétration du droit par la morale. Ainsi en est-il de :
- l'abus de droit, défini comme le fait, pour une personne, d'utiliser un droit qui lui est conféré dans le seul but de nuire à autrui. L’abus de droit est sanctionné par la réparation en nature (l’auteur de l’abus doit faire cesser l’abus, en faisant disparaître sa cause ou ses effets) ou en argent (l’auteur de l’abus doit verser des dommages et intérêts à la victime).
- l'enrichissement injustifié, qui désigne une situation dans laquelle une personne a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui et qui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Bonus : Citations sur le droit et la morale
Si vous avez une dissertation à rédiger sur le sujet du droit et de la morale, il peut être opportun d'y inclure quelques citations (vous pouvez notamment utiliser une citation en guise de phrase d'accroche).
A ce titre, vous trouverez ci-dessous plusieurs citations sur le thème du droit et de la morale.
« Le droit n’est pas une fin en soi, il ne prend son sens que par les valeurs qu’il traduit » (P. Malaurie, Notre droit est-il inspiré ?, Defrénois 2002, p. 637)
« Il n’y a en réalité entre la règle morale et la règle juridique aucune différence de domaine, de nature et de but ; il ne peut y en avoir, car le droit doit réaliser la justice et l’idée du juste est une idée morale » (G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4 e éd., LGDJ, 1949)
« Sans être ni idéaliste ni sceptique, il faut bien admettre qu’il y a une certaine intégration, variable, de la composante morale dans le processus juridique » (P. Jestaz, Pouvoir juridique et pouvoir moral, Mc Gill Law Journal, vol. 32, 1987, p. 835)
« Il n’existe pas de principe autonome du droit, du fait qu’il ne peut se détacher de la morale » (J. Freund, Droit et politique. Essai de définition du droit, Archives de philosophie du droit, 1971, repris dans Politique et impolitique , Sirey, chap. 21, p. 283)
« L’Etat de droit est l’effectuation de l’intention éthique dans la sphère du politique » (P. Ricoeur, Ethique et politique, Autres temps, 1985, p. 67)
J'espère que cet article vous aura été utile.
Sachez également que si vous avez une dissertation à faire sur le droit et la morale, vous pouvez vous aider du plan de cet article pour rédiger votre devoir.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour consulter mon article sur la méthodologie de la dissertation juridique .
Articles similaires :
Le droit et la religion [Dissertation]
Le syllogisme juridique : définition et exemple
Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences
L’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 [Fiche d’arrêt]

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .
Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.
Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.
Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.
J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.
Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .
J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .
Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .
J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.
A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

Suivez Fiches-droit.com sur les réseaux sociaux
Mentions légales
Conditions générales de vente
Politique de confidentialité
Liens utiles
La session a expiré
Veuillez vous reconnecter. La page de connexion s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Après connexion, vous pourrez la fermer et revenir à cette page.

- Aide aux devoirs
Sujets de dissertation sur Manon Lescaut de l'abbé Prévost et le Parcours Personnages en marge et Plaisirs du romanesque
Dans cet ouvrage de l’abbé Prévost, en quoi la représentation de personnages en marge participe-t-elle au plaisir romanesque ?
Plan détaillé:
I. Les personnages en marge comme moteur de l'intrigue
A. La représentation de Des Grieux et Manon Lescaut en tant que marginaux
B. L'attrait pour le romanesque à travers la transgression des normes sociales
II. L'apport de la marginalité à l'esthétique romanesque
A. L'évasion et l'aventure comme des formes de plaisir de lecture
B. Le tragique de la condition des personnages qui enrichit l'expérience romanesque
III. Les limites de la marginalité dans la construction du plaisir romanesque
A. Le dénouement tragique et la perte d'innocence
B. Le désenchantement et la désillusion comme conséquences de la vie en marge
Le goût pour la transgression permet-il d’expliquer le plaisir de lecture de cet ouvrage ?
I. La transgression comme source d'intérêt et de suspense
A. Les actions de Des Grieux et Manon Lescaut qui défient les normes sociales et morales
B. L'attirance pour le danger et le risque liée à leur comportement transgressif
II. L'attrait du lecteur pour la vie en marge
A. L'évasion de la réalité par l'expérience vicariante des personnages
B. L'excitation liée à la transgression des normes et à l'exploration de l'inconnu
III. La transgression comme vecteur d'une réflexion morale
A. La punition des transgressions comme un avertissement aux lecteurs
B. Le questionnement moral inhérent à la représentation de la transgression
La représentation de personnages en marge de la société participe-t-elle chez l’abbé Prévost à un projet littéraire satirique et moraliste ?
I. Le projet satirique de l'abbé Prévost
A. La critique de la société à travers la représentation de la marginalité
B. La dénonciation de la superficialité et du matérialisme de la société contemporaine
II. Le projet moraliste de l'abbé Prévost
A. L'utilisation des personnages marginaux pour illustrer des leçons de vie
B. L'importance de la vertu et des valeurs morales, soulignée par le sort tragique des personnages
III. Les limites du projet satirique et moraliste de Prévost
A. La complexité des personnages et leur humanité qui va au-delà de la satire et de la morale
B. L'ambiguïté morale et le réalisme psychologique qui nuancent le message moraliste
Ce roman de l’abbé Prévost représente-t-il seulement les aventures d’un jeune couple aveuglé par des passions ?
I. Les aventures de Des Grieux et Manon Lescaut comme reflet de leurs passions débridées
A. L'exploration des passions comme moteur de l'intrigue
B. La passion comme source de souffrance et de tragédie
II. L'analyse psychologique des personnages et leur évolution
A. Le portrait de Des Grieux et Manon Lescaut comme des individus complexes
B. L'évolution des personnages et leur prise de conscience progressive
III. Le roman comme une réflexion sur les valeurs morales et sociales
A. La critique de la société et ses valeurs matérialistes
B. La question de la liberté individuelle et ses limites
Peut-on dire que Manon Lescaut est la véritable héroïne de ce roman ?
I. Manon Lescaut comme personnage central de l'intrigue
A. Son rôle actif dans l'histoire et son influence sur Des Grieux
B. Sa complexité et son évolution au fil du roman
II. Manon Lescaut comme figure de l'héroïsme tragique
A. Sa résistance face aux épreuves et sa capacité à survivre dans des conditions difficiles
B. Son sacrifice final comme acte d'héroïsme
III. Les limites de la représentation de Manon Lescaut en tant qu'héroïne
A. Les aspects négatifs de son personnage et son rôle dans la chute de Des Grieux
B. Le débat sur le féminisme et la représentation des femmes dans le roman.
Sujet de dissertation :
En quoi Manon et Des Grieux, peuvent-ils être qualifiés de personnages marginaux?
Problématique: En quoi Manon Lescaut et le Chevalier Des Grieux incarnent-ils des figures de marginaux dans l'œuvre de l'Abbé Prévost ?
Introduction
Présentation de l'œuvre Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, en mettant l'accent sur son contexte historique et littéraire.
Introduction des personnages principaux, Manon Lescaut et le Chevalier Des Grieux, et de leur histoire d'amour tumultueuse.
Annonce de la problématique et du plan de développement.
I. La marginalité sociale et économique de Manon et Des Grieux
Analyse de la situation initiale de Des Grieux, issu de la noblesse mais rejetant son statut pour l'amour de Manon, soulignant sa descente vers une forme de marginalité.
Examen de la condition de Manon, caractérisée par sa précarité et ses choix de vie, qui la placent en marge de la société de son époque.
Discussion sur la manière dont leur relation amoureuse les éloigne encore davantage des normes et attentes sociales.
II. La transgression comme mode de vie
Exploration des choix de vie de Manon et Des Grieux, marqués par des actes de délinquance, de fuite et de manipulation, illustrant leur écart par rapport à la morale de leur temps.
Analyse des moments clés de l'œuvre où leurs transgressions les placent en opposition directe avec les lois et les valeurs de leur société.
Réflexion sur la manière dont ces transgressions renforcent leur statut de marginaux mais aussi leur lien mutuel.
III. L'isolement affectif et moral
Discussion sur le sentiment d'isolement que vivent Manon et Des Grieux, non seulement par rapport à la société mais aussi dans leur relation, marquée par des trahisons et des incompréhensions.
Analyse de la solitude morale de Des Grieux, partagé entre son amour pour Manon et ses propres principes éthiques.
Examen de la fin tragique de Manon comme ultime manifestation de sa marginalité, et de l'impact de cette fin sur Des Grieux.
Synthèse des éléments qui font de Manon et Des Grieux des figures marginales au sein de l'œuvre de Prévost.
Réponse à la problématique en soulignant comment leur marginalité est à la fois source de leur drame et élément central de leur histoire d'amour.
Ouverture sur la question de la marginalité dans la littérature du XVIIIe siècle et sa résonance avec des thématiques contemporaines.
L’histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut est-il un roman moral ?
Problématique: L'œuvre de l'Abbé Prévost, Manon Lescaut, peut-elle être considérée comme un roman moral à travers l'histoire d'amour entre Des Grieux et Manon ?
Présentation de Manon Lescaut et de son contexte littéraire au sein de la période de transition entre le classicisme et le préromantisme.
Brève introduction des personnages principaux, le chevalier Des Grieux et Manon Lescaut, et de l'intrigue centrée sur leur relation passionnelle.
Annonce de la problématique et du cadre d'analyse du roman sous l'angle de la moralité.
I. Les enseignements moraux à travers les personnages
Analyse de la trajectoire de Des Grieux, depuis son innocence initiale jusqu'à sa déchéance morale, comme illustration des dangers de la passion démesurée.
Examen des choix de vie de Manon, entre amour et aspiration à une vie aisée, et la manière dont ces choix reflètent les dilemmes moraux de l'époque.
Discussion sur la manière dont les personnages secondaires et les situations dans lesquelles Manon et Des Grieux se trouvent posent des questions éthiques et morales.
II. La critique sociale et les valeurs morales de l'époque
Exploration du contexte social de l'œuvre, marqué par une critique implicite des inégalités sociales, du matérialisme et de la corruption, qui constituent le toile de fond moral du roman.
Réflexion sur le traitement de la justice et de la rédemption dans l'œuvre, et leur rapport avec les notions de bien et de mal.
Analyse de la fin tragique de l'histoire comme possible leçon morale sur les conséquences de la déraison et de l'immoralité.
III. Le roman moral à travers la narration et la structure
Discussion sur le rôle du narrateur et la structure du récit dans la transmission des leçons morales, notamment à travers le regard rétrospectif de Des Grieux sur sa propre vie.
Examen de la préface et des commentaires de l'auteur qui encadrent l'histoire, offrant une perspective morale explicite sur les événements narrés.
Réflexion sur l'ambiguïté morale de l'œuvre, entre roman d'apprentissage et tragédie amoureuse, et son impact sur l'interprétation des valeurs morales véhiculées.
Synthèse des arguments présentés en réponse à la problématique, soulignant la complexité de Manon Lescaut en tant que roman moral.
Réflexion sur la portée de l'œuvre de Prévost et sa capacité à susciter une réflexion morale chez le lecteur, malgré ou grâce à ses ambiguïtés.
Ouverture sur la réception de l'œuvre au fil des siècles et son inscription dans le débat sur la moralité dans la littérature.
Sujet de dissertation :
En quoi le roman Manon Lescaut peut-il être qualifié de tragédie ?
Problématique: De quelle manière les éléments constitutifs et thématiques de Manon Lescaut de l'Abbé Prévost s'apparentent-ils à ceux d'une tragédie classique ?
Présentation de Manon Lescaut, dernière partie de l'œuvre L'Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, et de son contexte d'écriture au XVIIIe siècle.
Brève introduction de la notion de tragédie classique, centrée sur des personnages nobles confrontés à des destinées fatales en raison de leurs passions.
Annonce de la problématique et de la démarche analytique.
I. La fatalité et le destin tragique des personnages
Analyse du thème de la fatalité dans le roman, avec Des Grieux et Manon semblant inéluctablement poussés vers leur chute par une force extérieure ou un destin implacable.
Examen de la fin tragique de Manon et de la descente de Des Grieux, illustrant la notion de destin tragique inhérente à la tragédie classique.
Discussion sur la manière dont ces éléments de fatalité et de destin confèrent au roman une dimension tragique.
II. La passion destructrice comme force tragique
Exploration de l'amour passionnel entre Des Grieux et Manon comme élément central de la tragédie, conduisant à la perte morale, sociale et finalement physique des personnages.
Réflexion sur le concept de l'hybris, ou démesure, incarné par la passion dévorante de Des Grieux et les aspirations de Manon, menant à leur chute.
Comparaison avec des tragédies classiques où la passion amoureuse conduit également à la destruction des protagonistes.
III. La confrontation aux valeurs morales et sociales
Analyse de la manière dont Des Grieux et Manon se confrontent aux valeurs morales et sociales de leur époque, créant un conflit tragique entre leurs désirs et les normes de la société.
Discussion sur le rôle des personnages secondaires et des institutions (famille, justice) dans l'accentuation de la dimension tragique par leur opposition aux protagonistes.
Réflexion sur la critique sociale sous-jacente dans le roman, ajoutant une couche de tragédie liée à la condition humaine et aux structures sociales.
Synthèse des principaux éléments tragiques identifiés dans Manon Lescaut et réponse à la problématique.
Réflexion sur la singularité de l'œuvre de Prévost en tant que roman tragique dans le contexte littéraire du XVIIIe siècle.
Ouverture sur la résonance universelle de la tragédie dans la littérature et son adaptation au format romanesque.
Dans l'Avis de l'auteur des Mémoires d'un homme de qualité (p. 25), Prévost écrit : « J'ai à peindre un jeune aveugle qui refuse d'être heureux. » Dans quelle mesure cette formule vous semble-t-elle correspondre au personnage de Des Grieux ?
I. L'aveuglement de Des Grieux
Passion dévorante : L'aveuglement de Des Grieux peut être vu comme une métaphore de sa passion irrépressible pour Manon. Cette passion l'empêche de voir clairement les défauts de Manon et les conséquences désastreuses de leurs choix. Il est littéralement aveuglé par l'amour, ce qui le conduit à négliger les valeurs morales et sociales.
Refus de la raison : Des Grieux rejette souvent les conseils et les avertissements de ceux qui l'entourent, préférant suivre son cœur plutôt que sa raison. Cet aveuglement volontaire le conduit à répéter les mêmes erreurs, illustrant son refus d'apprendre de ses expériences passées.
II. Le refus d'être heureux
Quête insatiable : Le bonheur semble toujours hors de portée pour Des Grieux, non pas parce qu'il est intrinsèquement inaccessible, mais parce que Des Grieux lui-même érige des obstacles sur son chemin. Sa quête obsessionnelle de l'amour parfait, incarné par Manon, l'empêche de trouver une satisfaction durable dans les aspects plus stables et conventionnels de la vie.
Autodestruction : Le parcours de Des Grieux est marqué par une série de choix autodestructeurs qui semblent refléter un refus inconscient du bonheur. Sa dépendance à l'intensité des émotions que Manon lui procure le mène à des situations qui entravent son propre bien-être et sa stabilité émotionnelle.
III. La complexité de l'amour
Amour et souffrance : La relation entre Des Grieux et Manon est caractérisée par un cycle de plaisir et de douleur. Leur amour, bien que profond, est source de souffrance, montrant que le bonheur dans l'amour n'est pas un état permanent mais un moment fugace, souvent suivi de désillusion.
Idéalisme vs. Réalisme : Des Grieux est tiraillé entre son idéalisme romantique et la dure réalité de sa situation. Son incapacité à concilier ces deux aspects le place dans une position où le bonheur semble être un choix conscient qu'il refuse de faire, préférant l'intensité dramatique de sa relation avec Manon.
La description de Prévost d'un « jeune aveugle qui refuse d'être heureux » peut donc être appliquée à Des Grieux de manière métaphorique, soulignant son aveuglement face à la nature destructrice de sa passion pour Manon et son refus inconscient de trouver un bonheur plus tranquille et stable. Ce personnage, complexe et tragique, illustre la lutte intérieure entre la quête d'un idéal amoureux et la confrontation avec les réalités amères de la vie, thème central de l'œuvre de Prévost.
D'après votre lecture de Manon Lescaut, d'où peut provenir le plaisir de la lecture d'un roman ?
I. L'intensité dramatique et émotionnelle
Passions tumultueuses : La relation entre Des Grieux et Manon est marquée par une intensité dramatique élevée, avec ses nombreux rebondissements, trahisons et réconciliations. Cette intensité captive le lecteur et suscite une gamme d'émotions, allant de la sympathie à la frustration.
Empathie pour les personnages : Les lecteurs peuvent ressentir de l'empathie pour les personnages, surtout pour Des Grieux, dont les tourments et les dilemmes moraux sont décrits avec une grande profondeur psychologique. Cette identification émotionnelle renforce le plaisir de la lecture.
II. La qualité de l'écriture et la narration
Style narratif : La prose de Prévost est fluide et élégante, offrant une lecture agréable grâce à son style clair et à ses descriptions vivantes. La beauté de l'écriture en elle-même peut être une source de plaisir.
Structure narrative : Le récit est construit de manière à maintenir le suspense et l'intérêt du lecteur, avec un enchaînement habile des événements qui pousse à tourner les pages pour découvrir la suite.
III. Les thèmes universels
Exploration de l'amour et de la passion : "Manon Lescaut" explore des thèmes universels comme l'amour, la passion, la trahison et le pardon, qui résonnent avec les expériences personnelles des lecteurs. La réflexion sur ces thèmes intemporels peut enrichir l'expérience de lecture.
Quête de liberté et de bonheur : Les personnages principaux sont en quête de liberté et de bonheur, des aspirations profondément humaines. Cette quête, avec ses succès et ses échecs, invite à la réflexion sur la condition humaine.
Le plaisir de la lecture de "Manon Lescaut" découle de la combinaison de l'intensité émotionnelle de l'histoire, de la qualité de l'écriture, de la richesse thématique, et de l'aperçu qu'elle offre sur une époque révolue. Ces éléments, en interagissant, créent une expérience littéraire riche et nuancée, capable de captiver et de toucher le lecteur à différents niveaux.
Sujet de dissertation :
Dans l'Avis de l'auteur des Mémoires d'un homme de qualité, il est affirmé que « L'ouvrage entier est un traité de morale, réduit agréablement en exercice. » Êtes-vous d'accord avec cette assertion ?
I. La dimension éducative de l'histoire
Leçons tirées des expériences : Les personnages de l'œuvre, notamment Des Grieux dans "Manon Lescaut", traversent une série d'épreuves qui illustrent les conséquences de divers choix et comportements. Le récit de ces expériences peut être vu comme une série de leçons de vie, offrant au lecteur une réflexion sur les conséquences morales de nos actions.
Mise en garde contre les excès : Le parcours de Des Grieux peut être interprété comme une mise en garde contre les excès de passion et les dangers de la dévotion aveugle, soulignant l'importance de la modération et de la prudence dans la conduite de sa vie.
II. La complexité des questions morales
Ambiguïté morale : Les situations présentées dans l'œuvre ne sont pas toujours clairement définies en termes de bien et de mal, reflétant la complexité des dilemmes moraux auxquels les individus sont confrontés dans la vie réelle. Cette ambiguïté invite le lecteur à une réflexion plus nuancée sur la morale.
Empathie et compréhension : En dépeignant les personnages de manière empathique, même lorsqu'ils commettent des erreurs, Prévost encourage le lecteur à comprendre la nature humaine dans toute sa complexité, plutôt qu'à porter des jugements hâtifs.
III. La représentation des valeurs sociales
Critique des normes sociales : À travers les tribulations de ses personnages, Prévost expose et critique certaines normes sociales de son époque, notamment en ce qui concerne l'amour, l'argent, et le statut social. Cette critique peut être perçue comme une exploration des valeurs morales sous-jacentes à ces normes.
Réflexion sur la justice et la rédemption : Le roman aborde également des thèmes tels que la justice, le pardon, et la possibilité de rédemption, offrant ainsi une méditation sur la capacité humaine à changer et à se racheter.
En considérant "Manon Lescaut" et les "Mémoires d'un homme de qualité" comme un "traité de morale, réduit agréablement en exercice", on reconnaît que, au-delà de son intrigue captivante, l'œuvre engage le lecteur dans une réflexion profonde sur les valeurs morales et les dilemmes éthiques. Cette dimension morale, présentée de manière accessible et divertissante, enrichit l'expérience de lecture et confirme la pertinence de l'affirmation de l'auteur.
De quelle manière le roman peut-il critiquer la société ? Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre lecture de Manon Lescaut et des textes étudiés dans le cadre du parcours associé.
I. La représentation des conflits sociaux et personnels
Conflits entre désirs personnels et contraintes sociales : Dans "Manon Lescaut", le dilemme de Des Grieux entre son amour pour Manon et les attentes sociales relatives à la conduite morale et à la réussite sociale illustre la tension entre les aspirations individuelles et les normes sociales. Cette tension reflète les conflits internes que beaucoup éprouvent face aux exigences souvent restrictives de la société.
Critique des institutions : Le roman peut également critiquer directement les institutions, comme le fait "Manon Lescaut" à travers la représentation du système judiciaire et pénitentiaire, montrant comment ils peuvent être à la fois impitoyables et inefficaces.
II. La satire des mœurs et des valeurs
Exposition des hypocrisies : Le roman satirique expose souvent les hypocrisies et les contradictions des normes sociales. Par exemple, la relation entre Manon et Des Grieux, ainsi que les stratagèmes qu'ils déploient pour maintenir leur liaison, mettent en lumière les contradictions entre les idéaux amoureux romantiques et les réalités matérialistes de la société.
Critique des valeurs matérialistes : La quête incessante de richesse et de confort matériel est un thème récurrent dans la littérature, souvent présenté de manière critique pour montrer comment ces valeurs peuvent corrompre l'intégrité morale et les relations humaines.
III. L'exploration des marges de la société
Personnages marginaux : Les romans, en particulier ceux qui s'inscrivent dans une veine réaliste ou naturaliste, donnent souvent la parole à des personnages issus des marges de la société. Dans "Manon Lescaut", Manon elle-même, ainsi que la vie itinérante qu'elle mène avec Des Grieux, offrent un aperçu de la vie des personnes qui existent en dehors des structures sociales traditionnelles.
Questionnement des normes de genre : Les romans peuvent également critiquer les rôles de genre traditionnels en présentant des personnages qui défient les attentes de leur sexe, comme Manon, dont la manipulation et l'autonomie dans ses relations avec les hommes remettent en question les idéaux féminins de l'époque.
À travers des personnages complexes, des intrigues captivantes et des contextes sociaux richement dépeints, le roman offre un moyen puissant de critiquer la société. "Manon Lescaut", avec sa peinture détaillée des passions humaines et des contraintes sociales, sert d'exemple de la façon dont la littérature peut explorer et remettre en question les structures et les valeurs de son temps. En combinant l'analyse de ce roman avec d'autres œuvres étudiées, on peut saisir la portée et la diversité des critiques sociales que le roman, en tant que genre, est capable de formuler.
Écrire commentaire
Esma ( mardi, 21 novembre 2023 21:41 )
ATAMATA ( mercredi, 12 juin 2024 10:58 )
CACABOUDIN ( mercredi, 12 juin 2024 11:00 )
- Défiler vers le haut
Corrigé du bac français 2024 : découvrez celui des sujets de la série générale et technologique
Ce vendredi matin, les lycéens en fin de première des séries générale et technologique ont planché sur leur sujet du bac français 2024. Chaque sujet a été corrigé, découvrez-le sans attendre votre note !

Ce vendredi 14 juin 2024, les élèves de première ont passé leur épreuve anticipée écrite de français. Ci-dessous, vous pouvez retrouver le corrigé du sujet pour la série générale et le sujet pour la série technologique ainsi que les commentaires de nos professeurs qui chaque année rédigent les sujets.
Pour rappel : consultez ici les sujets du bac français 2024
Corrigé du bac français - général
1- Commentaire (20 points)
Objet d’étude : le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle
Commentaire :
Cette année le sujet de commentaire ne propose pas, au premier abord, de difficulté de sens. Le paratexte permet de bien situer l’extrait et d’en comprendre les enjeux, et le lexique reste tout à fait accessible pour un élève de Première Générale. Il s’agit d’un extrait de roman d’une autrice qui n’est pas, a priori, connue des élèves : Claire de Duras. Il ne faudra donc pas s’attarder sur des considérations sur son inscription dans un mouvement littéraire précis. Toute la difficulté pour les élèves résidera dans le fait de saisir les enjeux du texte en proposant différents niveaux de lecture et d’interprétation.
Il convient de rappeler que le plan proposé n’est qu’une possibilité parmi d’autres et que les candidats seront surtout évalués sur la cohérence de leur plan et la rigueur de leur analyse.
En quoi l’élévation morale et esthétique des personnages renforce la manifestation de la souffrance amoureuse ? Comment ce texte met en scène un amour impossible ?
A. L’expression de la plainte amoureuse
- Un amour mélancolique et idéal d’inspiration romantique
- La souffrance du narrateur ; une inflexion élégiaque
- Un aveu qui ne peut s’accomplir
B. La nature se fait l’écho des sentiments personnels
- Le locus amoenus ; un paysage état d’âme
- Un portrait en clair-obscur
- Le jasmin comme symbole d’un amour pur et intouchable
C. Un amour rendu impossible par des règles sociales
- Une situation cruelle et injuste suggérée avec dignité et morale
- Le contraste entre la proximité et l’inaccessibilité renforce le sentiment de désespoir
- Un héritage littéraire (L’amour courtois, Roméo et Juliette)
2. Dissertation (20 points)
Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXle siècle
Dissertation :
Commentaire : Cette année, les trois questions de dissertation sont assez classiques, et correspondent bien aux parcours associés. Les candidats ne seront donc pas a priori déstabilisés. Cependant, la difficulté réside dans la nécessité de reformuler les propos rapportés par des critiques ou par les auteurs eux-mêmes.
Œuvre : Rimbaud, Cahier de Douai, de « Première soirée » à « Ma Bohème (Fantaisie) » Parcours : émancipations créatrices
Voici une suggestion de plan :
A. Un éloignement spirituel et esthétique
- Le vagabondage et l’errance
- La fuite du monde contemporain au profit de la nature
- Une esthétique qui s’éloigne de l’héritage littéraire par son prosaïsme
B. Cependant une réinscription dans le monde
- La valorisation du quotidien et du banal
- Une poésie engagée qui soulève des enjeux contemporains
- Des références communes (histoire et mythes)
C. Un retour vers soi
- Partir de soi, de ses expériences pour atteindre l’universel
- Un jeu esthétique entre tradition et langage personnel pour créer une poésie nouvelle.
Ponge, La Rage de l’expression
La question proposée : Selon un critique, La rage de l’expression donne à voir l’écriture en plein travail et se regardant travailler. » Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ? Il était possible de répondre à cette question de manière dialectique ou thématique.
A. Certes, La Rage de l’expression est un recueil qui exhibe son processus de création
- Une nouvelle construction poétique
- L’entrée dans l’intériorité du poète et dans son cheminement poétique
- Les corrections et les versions successives apparentes
B. Ponge met surtout l’accent sur le travail du langage
- Des poèmes – définitions
- Une réflexion partagée sur le langage
- Un jeu métalinguistique
C. C’est plutôt le lecteur qui fonde par son regard la construction poétique
- La réhabilitation de l’importance du lecteur
- La construction de connaissances communes
- Une complicité entre le poète et le lecteur
Hélène Dorion, Mes forêts
La question proposée : « Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit : « mes forêts racontent une histoire ». En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ? Henri Meschonnic : « La poésie ne raconte pas d’histoire ». (Les états de la poétique). Prenant à rebours cette formule, Hélène Dorion affirme, elle, que sa poésie raconte une histoire. On peut ici opposer les dimensions lyriques et narratives de la poésie. Dans quelle mesure la poésie d’Hélène Dorion est-elle narrative ?
A. Certes Mes Forêts racontent l’histoire du monde
- En faisant référence à l’évolution naturelle
- En rappelant sans cesse l’âge des arbres, en faisant des liens avec le temps géologique
- En racontant une histoire sur notre monde
B. Cependant, le recueil Mes forêts propose d’abord une introspection, une pause lyrique
- Des sentiments variés : angoisse et espérance
- Une composition non linéaire
- Dorion récuse le nom de recueil mais préfère « livre de poèmes » pour souligner son travail de composition
C. Un cheminement personnel, une exploration de cet espace intérieur que sont « ses » forêts
- Importance du thème du voyage, de l’exploration
- Une quête vers soi
- Se retrouver dans la nature pour se retrouver soi-même
Marie Chauveau, Professeure de Lettres agrégée au Lycée Clemenceau de Montpellier
Corrigé du bac français - séries techno
1. Commentaire
Le sujet donné repose sur un extrait de Wajdi Mouawad, auteur contemporain qui s’illustre dans de multiples genres, souvent connu par les élèves pour son théâtre, plus précisément pour sa tragédie Incendies, le Sang des promesses.
Le sujet pouvait donc dérouter les candidats puisqu’il s’agit d’un extrait de roman et non de théâtre, comme l’indique l’objet d’étude choisi « le roman et le récit du Moyen-Âge au XXème siècle ». Mais le style d’écriture, contemporain et poétique, agréable à lire et facile à comprendre, a pu rassurer les candidats en bac technologique.
Il s’agissait de construire un commentaire à l’aide des deux axes proposés : un monde dangereux puis un récit surprenant. Ainsi, ces deux propositions amenaient les candidats à porter attention à la dimension tragique et épique de l’extrait mais aussi, par le deuxième axe, à particulièrement veiller au point de vue adopté, comme l’indiquait le paratexte : celui d’un animal, d’une grue. Ce décentrement anthropologique semble d’ailleurs inscrire le sujet dans des préoccupations contemporaines et actuelles autour de l’écologie, du spécisme et de l’attention au monde vivant.
Ainsi, voici une proposition de plan (il convient de rappeler ici que ce n’est pas le seul plan possible et que les élèves seront évalués sur la cohérence et la précision de leur analyse et l’organisation des idées), qui s’organiserait autour de la problématique suivante : Comment cet extrait, particulièrement épique et poétique, dénonce t-il le mépris de l’homme envers la nature ?
I- Un monde dangereux
A) une tempête redoutable
Les candidats pouvaient porter attention à la description de la tempête et percevoir la construction en crescendo de l’extrait ; qui débute par « le souffle glacial » et se conclut par « les gifles de la tempête ». Les nombreux adverbes et connecteurs logiques renforcent cette construction en crescendo qui va de la menace de l’orage au déchaînement de la tempête.
De nombreuses hyperboles telles que « le souffle glacial », « l’air s’engouffrait dans nos gueules ouvertes et déchirait nos joues », ponctuent le texte pour accentuer le caractère violent, imprévisible et meurtrier de l’orage.
On pouvait aussi être attentif aux personnifications et aux métaphores qui rendent la tempête monstrueuse et tragique.
B) une lutte terrible entre l’animal et les éléments
Dans cette deuxième sous-partie, l’on pouvait explorer la dimension épique du passage, en s’intéressant à la lutte entre le protagoniste (qui s’avère être une grue comme l’énonce la fin de l’extrait) et la tempête.
Le récit met en scène le combat entre la nuée et les éléments, par un ensemble de verbes qui dramatisent cette lutte. On pourrait également remarquer les nombreuses énumérations qui donnent à voir cette lutte acharnée.
Le combat s’avère particulièrement féroce et virulent, comme l’indiquent les énumérations et les hyperboles qui font des grues, des êtres de papier démembrés, détruits, écrasés par la tempête.
Le point de vue interne, immersif, renforce la violence de cette lutte.
II- Un récit surprenant
A) une chute tragique
Les axes proposés amenaient les candidats à porter attention à la structure en chute de l’extrait : la grue, après une lutte acharnée et de nombreux congénères morts, semble avoir gagné le combat mais se fait écrasée, tuée par une paroi vitrée. Cette fin tragique se présente comme soudaine et inattendue, grâce à des effets d’attente qui retardent l’annonce la mort du protagoniste et la cause de cette mort. On pouvait relever des périphrases telles que « un mur en mouvement » et « monstre métallique ». La mort de la grue est présentée comme une agonie insupportable.
B) l’harmonie de la Nature altérée par l’homme
Dans cette dernière partie, l’on pourrait s’attarder sur le style poétique du passage employé pour décrire le combat : les grues, par un ensemble de métaphores et de personnifications, deviennent des êtres sages et avertis, fins connaisseurs de la nature et qui, par l’expérience de « la plus âgée », savent lire le monde qui les entoure. L’agilité et la grâce de ces oiseaux se révèlent par le combat avec les éléments.
La tempête, bien que redoutable, est métaphorisée en un élément majestueux, grandiose : la blancheur et la pureté sont mises en avant. Le combat s’apparente alors à une danse cruelle.
Or, le deuxième paragraphe clôt le passage dans un ensemble de métaphores et en antithèse avec celles employées plus tôt : c’est la noirceur, l’obscurité et la lourdeur qui ressortent de ces dernières phrases. Et le seul passage dialogué, qui rapporte les paroles de l’homme, s’avère prosaïque.
C’est bien cette symbolique antithétique, accentuée par le style poétique de Wajdi Mouawad, qui amène le lecteur à saisir la portée dénonciatrice du passage : dénoncer les agissements de l’homme qui nuisent à l’harmonie de la nature.
Sujet A : Rabelais, Gargantua
Texte : Manon Paulic, Le défi de l’éducation
Les idées qui devaient être trouvées dans cet extrait :
- L’arrivée de CHATGPT perturbe considérablement le domaine de l’éducation car cela amène les enseignants à reconsidérer leurs pratiques, notamment celle de la correction.
- Des moyens de lutte contre la tricherie rendue facile et possible par cette IA sont mises en place et expérimentées au quatre coins du monde mais s’avèrent inefficaces et à l’encontre de la nécessité de maîtriser les outils numériques.
- Il est donc nécessaire d’introduire les intelligences artificielles dans les pratiques enseignantes, d’amener les élèves à les utiliser sciemment et avec éthique.
- Cette introduction pourrait révolutionner positivement l’enseignement et développer chez les élèves, et chez les étudiants, de nouvelles capacités cognitives qui pourraient les aider à mieux affronter le monde actuel. Mais cette introduction des intelligences artificielles ne va pas sans risques et sans dérives.
Essai : Une bonne éducation peut-elle se passer d’emmagasiner des connaissances ?
Les candidats pouvaient s’appuyer sur l’étude de Gargantua (Rabelais) pour répondre à cette question et construire leur réflexion autour des arguments suivants :
- les connaissances sont nécessaires au développement d’un esprit critique, à la conscience de valeurs et de principes nécessaires pour l’épanouissement personnel mais aussi pour s’inscrire dans la société.
- Mais la méthode de l’apprentissage, celle de l’emmagasinement est à interroger :
Ce terme renvoie à l’apprentissage par le « par cœur » ainsi qu’à la méthode de « l’oie gavée » (apprendre beaucoup en peu de temps). Cette méthode semble efficace pour acquérir des automatismes et est souvent mise en place dans les pratiques scolaires, dès le plus jeune âge. La répétition est également une méthode sur laquelle se fonde l’éducation à la maison : utile, efficace pour acquérir des automatismes, des réflexes de politesse par exemple.
Or, emmagasiner peut également supposer apprendre sans comprendre, ce que dénonce les humanistes dont Rabelais : apprendre ainsi c’est apprendre superficiellement. L’apprentissage efficace et propre au développement personnel nécessite du temps, de la compréhension et de la réflexion : c’est la métaphore du miel, de la digestion présente dans les œuvres de Rabelais.
Sujet B : La Bruyère, Les Caractères, livre XI « De l’Homme » – Parcours : peindre les Hommes, examiner la nature humaine.
Texte : Mélanie Semaine, « Restons polis, Mais pourquoi ? »
- La politesse semble enrayer une spontanéité qui dévoilerait notre nature profonde en déchéance à cause des mœurs car la société actuelle est axée sur la superficialité, sur le besoin impérieux de sans cesse se comparer aux autres, sur la nécessité d’être semblable aux autres alors qu’elle devrait amener chacun d’entre nous à aspirer à des valeurs morales et s’affirmer intimement.
- La politesse est donc un artifice qui entretient ces valeurs superficielles. Il deviendrait ainsi nécessaire de discréditer cette politesse pour dévoiler la sincérité, la véritable nature de chacun. Or, la politesse semble un principe primordial dans la société actuelle. La supprimer se révèle être une utopie, puisque cela nécessite une fine connaissance de soi et une acceptation totale de ce que les autres pensent. Sans politesse, vivre en société semble être compromis, difficile.
Essai : Pensez-vous que les marques de sociabilité comme la politesse nous empêchent de connaître les hommes tels qu’ils sont ?
Les candidats pouvaient s’appuyer sur l’étude des Caractères (La Bruyère) pour répondre à cette question et construire leur réflexion autour des arguments suivants :
- Notre société, comme le reflète notre éducation, est particulièrement vigilante et sensible aux marques et aux démonstrations de politesse qui semblent créer une cohésion, un bien-vivre ensemble. La politesse semble également permettre à chacun de trouver et de faire reconnaître sa place dans la société, d’affirmer et de faciliter les relations sociales entre individus, nous poussent à passer de Soi à l’Autre.
- Mais la politesse est aussi un moyen de cacher, de détourner nos états d’âme les plus profonds. Par la maîtrise parfaite de la civilité, il nous est possible de manipuler l’autre et ainsi, de lui dissimuler nos véritables intentions, malsaines et immorales, comme l’indique La Bruyère dans le chapitre « De l’Homme », plus précisément dans les remarques 31 et 32. Par les marques de sociabilité, il peut être également facile d’imposer un rapport de force avec l’autre, de le dédaigner et de le mépriser subtilement (remarque 69 sur la Modestie, de La Bruyère).
Sujet C : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Texte : Marie-Eve Thérenty, « De la Fronde à la guerre (1897-1918) : les premières femmes reporters »
- En créant des reportages sur la guerre, les femmes journalistes ont pu affirmer leur liberté et rivaliser avec les hommes journalistes.
- Si les femmes n’avaient pas le droit d’aller sur le front, elles employaient dans leur écriture un ensemble de procédés stylistiques et de formules qui alimentaient la propagande de guerre. Les reportages de guerre féminins ont alors été distingués en deux catégories : ceux de l’infirmière et ceux des femmes qui sont derrière le front.
- Par cette catégorisation, les récits autour de la guerre écrits par les femmes gagnent en crédibilité et en popularité et affirment ainsi le rôle du genre féminin dans la guerre.
- Si ces récits de guerre ont eu tendance à réaffirmer une distinction de genre entre homme et femme, ils modifient les critères habituellement attribués aux femmes. Ainsi, ces récits permettent de modifier la perception qu’a la société de la femme.
Essai : En quoi le fait d’écrire est-il une arme dans la lutte pour l’égalité ?
Les candidats pouvaient s’appuyer sur l’étude de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (Olympe de Gouges) pour répondre à cette question et construire leur réflexion autour des arguments suivants :
- Il est possible d’employer de nombreuses formes et de nombreux outils littéraires et stylistiques pour dénoncer les inégalités et ainsi susciter l’indignation des lecteurs ; les amener à prendre conscience de ces inégalités et à lutter contre celles-ci. Olympe de Gouges emploie une argumentation directe, particulièrement virulente et persuasive dans le préambule et le postambule pour dénoncer la société patriarcale et sexiste de son temps.
- Il n’est pas rare que des œuvres écrites, littéraires, journalistes ou rhétoriques aient permis de lutter efficacement et concrètement contre les inégalités et les discriminations telles que le racisme ou la grossophobie.
- Écrire permet d’ancrer les luttes pour l’égalité dans une certaine intemporalité et universalité et d’ainsi, permettre une lutte à plus long terme. On peut se rappeler que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n’a été véritablement redécouverte qu’au XXème siècle et régulièrement relue par les mouvements féministes actuels.
Consultez aussi
- Sujet et corrigé du bac français 2023
- Résultats du bac
- Résultats du bac français
- Bac français : l’oral - guide et méthodo
- Bac français : l’oral - conseils d’un prof pour réussir l’oral, les pièges à éviter…
- Bac français : l’écrit - guide et méthodo pour réussir ses 4 heures d’examen
Écoles à la une
Proposées par les écoles partenaires.


IMAGES
VIDEO
COMMENTS
A. La morale est le sentiment dont le contrat social est le substitut artificiel. Celui-ci est une liberté, puisqu'il permet de s'émanciper des injustices nées de la vie en groupe. B. La morale, créée par la conscience, est une illusion qui permet de responsabiliser autrui par rapport à ses actes.
La morale : plans de dissertations et corrigés de commentaires de textes philosophiques. Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h: - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de ...
Afin que vous compreniez mieux comment réaliser une bonne introduction de dissertation, je vous montre ici plusieurs exemples d'introduction de dissertation en philosophie sur des sujets différents, vous pouvez voir la méthode en VIDEO ici. Pour davantage d'information sur la méthode à suivre vous pouvez regarder cet article sur la ...
Révisez en Terminale S : Cours La morale : introduction avec Kartable ️ Programmes officiels de l'Éducation nationale. 01 76 38 08 47. ... Cette morale est un compromis entre la "morale pure" et le pragmatisme qui insiste sur les moyens de la réussite. Le risque de l'utilitarisme réside dans sa mauvaise interprétation qui peut conduire ...
La liberté, le devoir. La morale est une réflexion sur nos pratiques, nos actes, nos comportements et correspond à la question de Kant : « Que dois-je faire ? » Elle a pour valeur le bien, et ...
Nous publions ici le corrigé type du 1er sujet de l'épreuve de philosophie du bac réservé aux élèves de la série ES lundi 17 juin. Voici un corrigé du premier sujet de l'épreuve de ...
Exemple de Dissertation; Aide à la dissertation; 18 Quizz de Philosophie gratuits : Testez-vous ! ... 10 Philosophes majeurs de la morale et leur œuvre morale principale : ... Il s'agit de la difference à établir entre l'ethique et la morale. Mieux la primauté de l'une sur l'autre. says: Charles Hébert. 18/05/2016 at 11:15 .
Une introduction est toujours structurée en 3 ou 4 étapes : Accroche (facultative) Définition des termes du sujet. Énoncé de la problématique. Annonce de plan. La personne qui corrige va chercher ces étapes dans votre texte. Si elle n'y parvient pas, c'est que votre introduction est confuse ou manque de structure.
6 novembre 2023 Pierre Aucun commentaire. La dissertation philosophique traitera du thème de la bonne conscience en relation avec la moralité. Le sujet nous invite à questionner les liens entre conscience morale personnelle et les standards universels de justesse et d'intégrité. Lire la suite. Dissertations.
La morale. L'essence et les manifestations de la morale. La morale : dissertations et commentaires corrigés sur Ma Philo.net - Aide personnalisée pour tous vos devoirs de philosophie, réponse à votre dissertation de philo en 1h chrono. Nos professeurs traitent tous les sujets, de tout niveaux, terminale, fac, classe prépa.
Le terme "morale" peut être considéré sous différents angles. Il peut s'agir des exigences morales dont est porteur le savant au même titre que n'importe quel autre être vivant en société. Il peut aussi s'agir de la déontologie - i.e. de l'ensemble des règles et des valeurs qui guident sa conduite - dans le domaine de recherche qui ...
Tout d'abord, elle permet d'introduire le sujet et de le situer dans son contexte philosophique. Ensuite, l'introduction a pour objectif de présenter la problématique de la dissertation. La problématique doit susciter l'intérêt du lecteur et mettre en évidence les différentes approches possibles du sujet.
L'introduction d'une dissertation permet de poser le sujet et d'exposer le problème auquel vous allez répondre dans le développement. L'introduction d'une dissertation ne doit pas être trop longue (10 à 15 lignes) et est censée s'adresser à un lecteur qui ignore le sujet. Elle doit comporter : une phrase d'accroche (amorce ...
Sujets de philosophie sur La morale corrigés sur Ma Philo.net - Page 1 - Aide personnalisée pour tous vos devoirs de philosophie, réponse à votre dissertation de philo en 1h chrono. Nos professeurs traitent tous les sujets, de tout niveaux, terminale, fac, classe prépa.
Les sujets du bac de philo pour la voie technologique en bref : Sujet de dissertation 1: La nature est-elle hostile à l'homme ?. Sujet de dissertation 2: L'artiste est-il maître de son travail ...
III) Le pouvoir basé sur la force a ses limites. La morale nous enseigne à faire le bien autour de nous, c'est-à-dire faire preuve d'altruisme, de bonté et de sympathie sans rien demander en retour. C'est le sens même de la notion de devoir, consistant à avoir une bonne volonté indépendamment du contenu de l'action.
La transmission de la morale par le regard d'un personnage sur un autre personnage (Huis-Clos « L'enfer c'est les autres », Don Juan et Sganarelle) ... dissertation sur la morale en littérature. Matière: Genres et histoire littéraire, méthodologie de la dissertation (W2AMELT3) 4 Documents.
Voici donc la morale fondée sur l'homme. L'avènement de cet humanisme moderne a signifié, pour beaucoup, la fin de la morale et de la spiritualité. Dieu est mort donc tout est permis ! Point besoin de religion pour être honnête ou charitable. Point besoin de croire en Dieu pour faire son devoir. Bien plus : le combat pour la laïcité demeure
L'introduction de la dissertation correspond au paragraphe qui débute ta copie. C'est une étape fondamentale de la méthode de la dissertation. Paradoxalement, s'il s'agit de la première partie de ta dissertation, l'introduction ne se rédige pourtant jamais en début d'épreuve. Ce n'est qu'après avoir élaboré ton plan ...
Sujet de dissertation : dans l' « Avis de l'auteur » des Mémoires d'un homme de qualité, qui précède Manon Lescaut, Marivaux écrit que son livre est un « traité de morale » sous la forme d'un roman. Que pensez-vous de cette affirmation? Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre
Clique ici pour t'inscrire ! Voici un exemple de dissertation sur Manon Lescaut de l'Abbé Prévost. (Parcours au bac de français : personnages en marge, plaisir du romanesque ). Important : Pour faciliter ta lecture, le plan de cette dissertation est apparent et le développement est présenté sous forme de liste à puces.
Bonus : Citations sur le droit et la morale. Si vous avez une dissertation à rédiger sur le sujet du droit et de la morale, il peut être opportun d'y inclure quelques citations (vous pouvez notamment utiliser une citation en guise de phrase d'accroche). A ce titre, vous trouverez ci-dessous plusieurs citations sur le thème du droit et de la ...
TD td dissertation le droit et la morale quid leges sine moribus (que sont les lois sans la morale de cicéron. ici, reconnaît un lien entre le droit et la. ... Un exemple criant de vérité sur cette affirmation réside à l'article 6 du Code civil, inchangé depuis le 15 mars 1803, qui prévoit que les conventions particulières ne peuvent ...
Sujet #1 Dans cet ouvrage de l'abbé Prévost, en quoi la représentation de personnages en marge participe-t-elle au plaisir romanesque ? Plan détaillé: I. Les personnages en marge comme moteur de l'intrigue A. La représentation de Des Grieux et Manon Lescaut en tant que marginaux B. L'attrait pour le romanesque à travers la transgression des normes sociales II.
Ce vendredi matin, les lycéens en fin de première des séries générale et technologique ont planché sur leur sujet du bac français 2024. Chaque sujet a été corrigé, découvrez-le sans ...